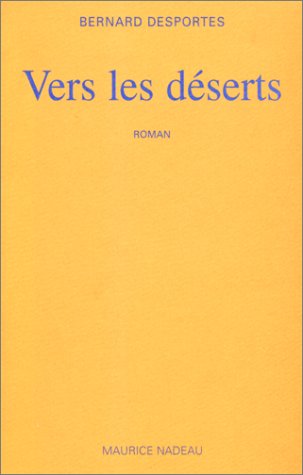Fondateur de la revue Ralentir travaux (qu’il dirige depuis 1995), Bernard Desportes s’est surtout fait connaître en tant que poète (deux recueils publiés aux éditions La Bartavelle), et en tant que prosateur, puisqu’il est aussi l’auteur de deux récits : La Vie à l’envi chez Maurice Nadeau et Nulle part, l’été, aux éditions de l’Aube. Ajoutez à cela un essai sur Koltès et vous aurez la quasi intégralité de cette œuvre naissante. Vers les déserts est donc son premier roman -et pour un premier roman, l’entreprise ne manque ni d’audace ni de profondeur.
L’originalité réside ici dans la forme. Il s’agit en effet d’un roman par fragments, placés les uns à la suite des autres, et séparés les uns des autres par un blanc typographique. Chaque fragment est composé d’une phrase unique (dont la longueur peut varier de quelques lignes à une bonne dizaine de pages), s’ouvrant sans majuscule et se refermant sans point, comme si l’amont et l’aval avaient disparu, comme si l’auteur lui-même n’était parvenu à retenir qu’une partie de la phrase. Entre ces deux extrémités non marquées (disons des extrémités ouvertes), qui laissent pour toujours la phrase en suspens, en attente d’ouverture et de fin, il y a un grand pan de texte, un paragraphe unique, lourd et dense comme dans les romans de Beckett, et de la douleur, des histoires de famille, des désirs d’inceste, des relations hautement pédophiles (Nulle part, l’été racontait déjà une histoire d’amour entre un homme jeune et un jeune garçon), des bribes d’enfance (mais alors une enfance endeuillée), un massacre qui ressemble étrangement à celui de Thorigné-sur-Dué (ce monde-là pourrait donc être le nôtre !), tout cela formant tant bien que mal un roman douloureux, qui nous renvoie au silence de la terre, à la mort, à la grande énigme de la vie.
Mais la réussite d’un tel roman tient surtout à sa matière. D’un côté, quelques villes : Logm, Glom, Mlog, Mgol ; de l’autre, des personnages sans vie, sans avenir ni passé, des entités désincarnées : Molo, Volo, Golo, mais aussi la mère, fossoyeuse en chef, la vieille, que le narrateur surprend « accroupie sous la table, claquant des dents de peur », et à laquelle il se permet parfois de penser, avec une malveillance presque obscène : « quand elle aura crevé, je la mettra dans la terre »… Dans ce roman, les noms propres paraissent se décliner : l’ami Vlap, en compagnie de Plav et Plov, aimait à boire un verre à Glav, sur les bords du Vlad… Dans l’esprit du lecteur (qui songe rarement à consigner sur des fiches les noms de chaque personnage et de chaque ville), ces anagrammes en viennent à se superposer, à se confondre, peut-être simplement parce que dans ce monde-là, où rien n’a vraiment de sens, où l’arbitraire règne en maître, où l’instinct régit les comportements humains, tout s’y avère interchangeable. Qu’il s’agisse de Plav ou bien de Plov, de Plav plutôt que de Plov, qu’importe : ce sont de pauvres bougres, englués dans une vie sinistre et sans horizon, « de ces gens venus de l’ombre et dont on ne sait ce qu’ils font où ils vont de quoi ils vivent ni ce qui les maintient en vie sur terre ». Leur mémoire porte une douleur sans fin.
L’intrigue, quant à elle, en impose par sa simplicité : baptisé Vlad à la va-vite par un père peu scrupuleux (lui-même nommé Znarf Akfak, ce qui prédispose peut-être au mauvais goût), pupille de l’assistance publique, abandonné par son père dès sa naissance, cependant que sa mère se permettait de périr des suites de l’accouchement (à côté, le destin de Cosette paraît enviable), placé ensuite chez une certaine Ammé Yravob (alias « la vieille »), le narrateur se pique soudain du désir de revoir son père. Pour ce faire, il entreprend un long voyage, sorte de quête des origines qui lui fait traverser les villes de Glog, Blav, Glav, Gdlarz, Zglard (en bateau), Logm, Glom, Mlog (là où s’arrêtent définitivement les rails), Mgol (là où la route s’achève brutalement, et où aurait séjourné un certain Samuel Joyce, chroniqueur de son état, et intime de Vlad), jusqu’à cette ville fantôme, affublée d’un nom imprononçable : Htrzmkv, « la ville noire », totalement coupée du monde, à mille lieues de toute présence humaine, considérée « comme inaccessible, nul moyen pour s’y rendre, la ville elle-même étant mouvante, changeante, jamais à la même place sur les cartes ». Un long voyage dégoulinant d’ennui et plein de l’horreur habituelle des transports collectifs, avec des gens qui puent, une marmaille qui braille, des odeurs de bouffe, et cette bêtise ambiante qui vous donne la nausée.
À l’issue de ce road-movie franchement gore, il y a l’échec, le terrible échec (même la nuit ne vient plus dans ce roman qui s’enfonce Vers les déserts au fil des pages), celui qui rappelle que « c’est toujours pour rien que le temps passe », à moins qu’il ne faille se satisfaire d’une terre sans herbe, vierge de vie, « pas même un lieu », d’un mélange de ciel, de terre et de vent, d’un no man’s land dans lequel le narrateur renoue avec la fatigue (la grande fatigue d’être sur la terre, de devoir continuer à chercher, au risque de ne jamais rien trouver), et pour finir avec l’absence et le silence. On comprend alors à quel point « vivre est une plaie, aussi une folie inexcusable ».
Une telle absurdité, un tel vide, tant de misère humaine, un humour aussi grinçant, des ressassements à ce point morbides, tout cela n’est pas sans rappeler Beckett (mais Cioran conviendrait aussi), et plus précisément cette angoissante odyssée qu’est Molloy (de la même manière que le lecteur oublie quelle peut être la quête de Molloy, le lecteur oublie ici ce que le fils recherche, oublie même qu’il cherche quelque chose, qu’il est un fils, et son errance ressemble alors à la dérive d’une vie banale, qui pourrait bien être la nôtre…). On songe même tellement à Beckett qu’on pourrait presque accuser Bernard Desportes d’en être devenu un épigone (un peu tardivement, ce qui surprend). Toujours est-il que son roman a une belle épaisseur (il ne serait pas vain de lire plusieurs fois le même fragment), une gravité authentique, avec peut-être un soupçon de complaisance envers le désespoir, et qu’il nous ramène à l’absurdité de notre séjour ici-bas : « chaque jour est pire que la veille, chaque jour qui vient vous fait regretter le jour passé, tout est toujours plus sombre, plus triste, plus désespérant ». Un roman qui fait fi des canons de l’époque, loin du petit pathos commercialement correct, et qui revient à l’universelle douleur de vivre.
Vers les déserts
Bernard Desportes
Maurice Nadeau
174 pages, 120 FF
Domaine français Grise odyssée
mai 1999 | Le Matricule des Anges n°26
| par
Didier Garcia
Avec l’impitoyable épopée d’un orphelin, Bernard Desportes signe un roman dérangeant. Entre l’absurde de Kafka et le vide de Beckett.
Un livre
Grise odyssée
Par
Didier Garcia
Le Matricule des Anges n°26
, mai 1999.