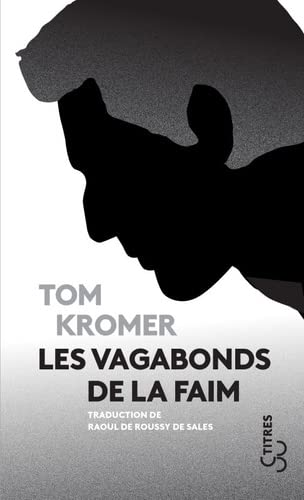Qu’on ne s’y trompe pas : Tom Kromer (1906-1969) n’est ni un hobo (ce vagabond volontaire épris de liberté, opposé à l’American way of life, que l’on retrouve dans les romans de Kerouac), ni un tramp (le travailleur saisonnier contraint au vagabondage pour trouver du travail), et encore moins un homeless (un sans-abri, le terme étant apparu aux États-Unis dans les années 1970), mais un stiff, nom argotique désignant à la fois un vagabond, un chômeur, et un mendiant par nécessité. Pour le formuler avec les propres mots de l’auteur : un homme « tombé dans la mouise », qui « n’est bon qu’à bouffer de la saloperie et à crever de froid ».
Découpée en douze chapitres, cette confession autobiographique présente l’essentiel de la vie d’un stiff (qui a tout perdu après avoir travaillé) : les jours de pluie (qui le glace jusqu’aux os), l’attente pour la soupe populaire, l’art de monter à bord d’un train en marche (sans y laisser un bras ou une jambe), les rares échanges avec les femmes contraintes elles aussi à la mendicité (et qui abandonnent parfois leur bébé dans un parc à défaut de pouvoir l’allaiter), ou avec les enfants qui viennent à la mission chercher « un seau de soupe et une miche de pain rassis », quand ce n’est pas la tentation d’un braquage (avec un revolver dérobé à un vagabond ivre, Kromer envisage de braquer une banque, mais une fois parvenu au guichet il ne parvient pas à sortir son arme, laquelle s’est accrochée dans la doublure de sa poche)…
Deux activités principales occupent ses journées : « Jour après jour, semaine après semaine, d’année en année, toujours la même chose : tâcher de bouffer et tâcher de dormir », le pire étant quand même de lutter contre la faim qui le tenaille (comme le lui fait remarquer une jeune femme qui doit se prostituer pour se nourrir : « On voit les choses d’un point de vue différent quand on n’a pas mangé pendant deux jours »). C’est une faim qui autorise tout, toutes les bassesses, toutes les compromissions, et qui fait accepter n’importe quoi, comme ces hommes riches qui le courtisent : « Je ne peux pas blairer ces tapettes, mais il faut que je bouffe » (et l’auteur plus loin d’ajouter que cet homme qui le drague est sa « carte de viande »).
Même si « le malheur isole » et que l’homme pauvre est solitaire, Kromer n’est pas le seul à vivre cette vie : autour de lui gravitent ses semblables, qui se débrouillent comme ils peuvent pour éviter de passer une nouvelle nuit sur un banc dans un parc (il y en a même qui s’installent dans des tas d’ordures, dont ils finissent par être délogés par la police). La misère leur fait côtoyer la mort de près, comme celle de ce jeune homme qui a mal apprécié la vitesse d’un train à bord duquel il a tenté de monter : « Son visage est livide maintenant. Toutes ses couleurs sont par terre ».
Ce que Kromer nous donne à lire dans ce livre publié en 1935 (et qui est d’ailleurs son seul roman), c’est la misère au quotidien, ou plutôt quelque chose qui se situe encore un cran en dessous de la misère, dans des régions où les hommes ne sont plus tout à fait des hommes (lui-même dit appartenir à un groupe que l’on désigne le plus souvent comme étant une « bande de pouilleux »). Une misère qui est une sorte de cauchemar continu, qu’il se coltine à longueur de journée, et qu’il évoque en utilisant le langage des vagabonds eux-mêmes. De là cette impression d’un texte écrit sans artifice littéraire (son auteur a été écrivain de manière accidentelle, et pour ainsi dire sans le vouloir), au style dépouillé et volontiers brutal, ce qui rend cette confession d’autant plus poignante (elle a souvent la violence d’un uppercut, Kromer ne faisant rien pour arrondir les angles, tout en ne donnant jamais dans le pathos).
On tient là le portrait d’un homme dont la vie se résume à une lutte pour survivre, et qui a perdu jusqu’au souvenir des belles années qu’il a vécues avant d’en arriver là : « Je ne revois que les trains sur lesquels j’ai vadrouillé, les cognes qui m’ont passé à tabac, et les gargotes des missions où j’ai mangé. » Un portrait qui dénonce malgré lui la société américaine (en l’occurrence celle de la Grande Dépression, née du krach boursier de 1929) et les laissés-pour-compte qu’elle engendre. Ce qui n’exclut pas, çà et là quelques traits d’humour, Kromer faisant parfois entendre un rire de dérision, aussi sinistre finalement que la misère qu’il évoque : le rire de celui qui est revenu d’à peu près tout, et qui a définitivement perdu ses illusions.
Didier Garcia
Les Vagabonds de la faim,
Tom Kromer
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Raoul de Roussy de Sales
Christian Bourgois, « Titres », 216 pages, 8,50 €
Intemporels À la rue
mars 2022 | Le Matricule des Anges n°231
| par
Didier Garcia
Tom Kromer entraîne son lecteur dans sa propre vie et dans les bas-fonds de la société américaine des années 1930. Une lecture oppressante.
Un livre
À la rue
Par
Didier Garcia
Le Matricule des Anges n°231
, mars 2022.