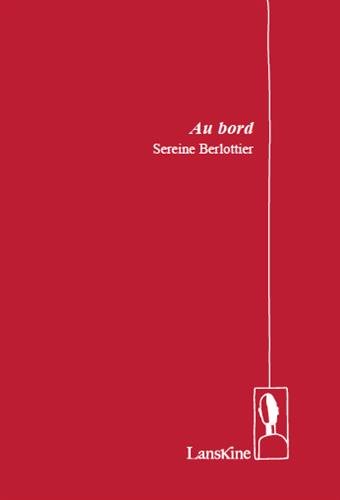Il y a des moments, on a envie de tout arrêter. Tout va trop vite. Rendez-nous le poème, rendez-nous le moment où la poésie nous donnait la force et le courage, rendez-nous la consolation, rendez-nous la beauté ! Il y a des moments, on voudrait dire aux poètes, vous voyez bien que pour la poésie c’est trop tard, vous voyez bien qu’elle est dépassée, tout va si vite. Que peuvent vos poèmes aujourd’hui ? Vous y croyez vraiment à la poésie en temps de crise ? À quoi servent vos poèmes à l’heure du réchauffement climatique ? Oh, arrêtez le poème, faites quelque chose, inventez autre chose, vous ne voyez pas que c’est fini depuis longtemps. On n’en est plus là.
Mais comment s’arrêter ? Il n’y a pas de frein ? On y va droit ? Devant nous, c’est un mur ? Le poème, dit, Giorgio Agamben, relance son rythme sur le frein de la césure. Il cite dans son Idée de la prose un distique de Sandro Penna : « Je vais vers le fleuve sur un cheval / Qui lorsque je pense un instant un instant / s’arrête aussi ». La pensée arrête le cheval à la césure. Mais, demande-t-il, qu’est-ce qui se pense là, au point d’arrêter le cheval du vers ? On connaît la réponse d’Hölderlin. Le transport rythmique qui donne au poème son élan est vide. Tel qu’il se manifeste à la césure, en cette interruption, le soulèvement rythmique ne vient désigner que le vide dont est fait son élan, en ce seul transport de lui-même. « Et c’est ce vide, poursuit Agamben, que la césure pense et tient en suspens, en tant que parole pure, pendant le bref instant où s’arrête le cheval de la poésie ». Vient un moment où ça s’arrête, on arrête de courir et on s’aperçoit qu’en dessous c’est le vide, jusqu’ici tout va bien, etc. Le poème dans cet arrêt ne pense plus rien que la voix qui le porte.
Et si on restait dans l’air ? Si, le temps du poème, on pouvait rester en suspension dans le vide ? Si on pouvait courir longtemps après que le sol se soit dérobé sous nos pieds ? Si le poème avait encore quelque pouvoir sur nos vies ? Si on pouvait y croire encore ? Si la césure n’était qu’une relance pour continuer encore, encore un peu, le temps d’y croire encore, le temps que ça ne s’arrête pas ?
Agamben cite Raymond Lulle. Un chevalier, raconte-t-il, allait à la cour, qui bercé par le pas de sa monture s’endormit en chemin. Quand à une fontaine sa bête s’arrêta, ayant perçu son immobilité dans son sommeil il se réveilla. Le poète se réveille et ne contemple rien d’autre que sa propre voix. On a tous en tête la voix de Rodolphe Burger chantant sur les paroles d’Olivier Cadiot : « Quand il s’arrête oh ce / cheval-mouvement / de la main ou ralentir / ralentir / son mouvement ». Quand il s’arrête le cheval, le poème ne semble ne plus pouvoir continuer, la poésie ne continue que sur la base de cet arrêt, à partir de ce point vertigineux, depuis ce vide même qui serait son échec et sa réussite ? Oh, arrêtez !
À quoi je pense quand je pense à ce à quoi pense le poème quand il s’arrête ? Je pense à ce que pense le cheval ? Je pense à au moins trois chevaux. Le premier est celui qui donne son titre au livre que Furukawa Hideo n’a pas pu ne pas écrire quelques mois après le tremblement de terre de 2011 à Fukushima : Ô chevaux, la lumière est pourtant innocente. Sous la dictée de la catastrophe que l’on sait, ce livre prend acte de l’impossibilité d’écrire comme il pouvait le faire avant. Il se demande ce qui peut être écrit encore, en ce temps où le temps sort de ses gonds : « Il faut des mots, une voix qui portent éventuellement jusqu’à la zone sinistrée. Mais dans les romans que j’ai écrits dans le passé, quels sont les mots qui passent encore ? » L’écrivain s’adresse dans son titre aux chevaux, choqué de découvrir que de nombreux animaux domestiques ont été abandonnés, livrés à eux-mêmes dans les zones sinistrées, à proximité de la centrale dévastée. La confiance qu’ils pouvaient faire aux hommes est trahie.
Le deuxième cheval auquel je pense au moment de ne penser que le vide est celui que filme l’artiste Adel Abdessemed, entravé comme à l’abattoir, frappé et tué à coups de marteau. Le titre de cette insoutenable vidéo est Don’t trust me.
Le troisième cheval est celui auquel j’ai d’abord pensé au moment de me demander quoi écrire dans cette chronique. C’est à partir de lui que j’aurais voulu pouvoir écrire ici si j’avais pu croire qu’il était encore possible aujourd’hui d’écrire sur un livre de poésie. C’est de lui dont j’aurais voulu vous parler si je n’avais pas plutôt envie de demander aux poètes d’arrêter leurs poèmes. Ce cheval, il court dans un alexandrin, vers épique par excellence, du livre de Sereine Berlottier, intitulé Au bord. Ce vers me donne des frissons tant il est beau, mais le cheval du poème voit-il vraiment où il va, et nous avec lui : « Aucun cheval ne galope les yeux fermés ».
Au bord, de Sereine Berlottier
Lanskine, 73 pages, 12 €
Quartier libre Aucun express ne m’emmènera
avril 2017 | Le Matricule des Anges n°182
| par
Xavier Person
Un livre
Aucun express ne m’emmènera
Par
Xavier Person
Le Matricule des Anges n°182
, avril 2017.