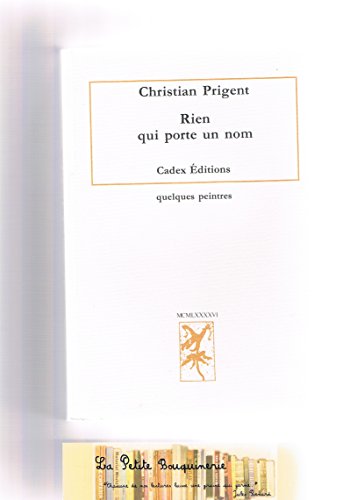Les observateurs myopes de l’histoire littéraire des dernières années avaient rangé un peu vite Christian Prigent dans la boîte désormais close des avant-gardes. Parce qu’il avait engagé un travail à la fois destructeur et regénérateur sur la langue et que, encore au moment où le terrorrisme telquelien découvrait le moelleux d’une situation de pouvoir (Sollers entrant chez Gallimard), parce qu’il continuait son travail de sape d’une « langue de tout le monde qui n’est la langue de personne » comme il le répète, on aurait voulu (la clique des tenants de la légitimité et les anciens maos convertis à la pensée(?) de Balladur) le considérer comme une sorte de dernier dinosaure de la modernité. Or voici que le bonhomme brouille un tant soit peu les pistes avec d’abord un premier roman Commencement (P.O.L, 1989) où s’affichait ostensiblement le genre dominant aujourd’hui : l’autobiographie.Peut-on être singulier et faire comme tout le monde ? La lecture de Commencement (un des livres les plus énergiques de ces dernières années) apportait une réponse positive à cette question, affirmation que vient confirmer aujourd’hui ce Une phrase pour ma mère. Le titre de ce roman est fallacieux dans la mesure où ce n’est même pas une phrase qui traverse le livre : y manque une majuscule de départ et un point à l’arrivée, deux marques que l’éducation nous apprend à respecter. On voit déjà que ce respect d’un ordre établi sans nous n’est guère du goût de l’auteur de Ceux qui merdre(P.O.L, 1991). L’ouvrage s’ouvre sur une scène primitive dans laquelle le narrateur enfant, « très petit dans l’émoi du lit très petit aussi », se réveille, léthargique, et voit les fesses de sa mère qui lui tourne le dos allongée sur son lit. C’est, métaphoriquement de l’image de cette chair, de ce derrière que va jaillir le babil de l’enfance d’abord, puis la vitesse accélérée d’une langue qui, dans sa forme même, cherche et trouve du sens. Ainsi, au-dessus des fesses de la mère trouve-t-on une « chemouise de nid » qui renvoie, dans son expression, à la condition d’oisillon du narrateur. Disons-le tout de suite : dans ses dérapages, ses allitérations, la mixion des langues où Lacan et Proust peuvent voisiner avec « Monsieur Leclerc qui t’envoie sympa la photo couleur de son rôti d’porc », ce livre est irrésistiblement comique. un comique qui ne manque pas d’être scatologiQue, comme si, cette autobiographie expulsée à vitesse grand V sur le papier ne pouvait naître que par le bas, ne venir au monde que par l’anus. Et lorsqu’on lit (p.168) : « on ne te voit pas, remarque ma mère, en figure nulle mais bien cernée par le rond de la bulle, dans ce que tu t’escrimes à montrer de toi, drôle de façon d’être en citoyenneté, ce dérapé généralisé ! », on devine que le divorce est grand entre une langue maternelle qui vise à intégrer l’individu dans le groupe, et cette langue que l’on découvre, qui nous fait rire, qui nous déstabilise et qui, définitivement, signe la singularité de celui qui la parle. On parlerait alors d’affranchissement par la langue mais on oublierait ce qui fait le drame de cette phrase pour ma mère : parler Prigent, c’est le risque de n’être pas compris par maman Prigent. C’est donc aussi, en cassant une langue impropre à dire ce que l’on est, dresser entre soi et les autres cette langue qui nous est propre autant, hélas, qu’elle paraît opaque aux autres.Derrière le rire de Une phrase pour ma mère, on ne peut s’empêcher d’entendre les balbutiements d’une quête à l’universelle singularité.
Si ce roman rejoindra sur l’étagère des livres qu’on ne finit jamais de lire et relire Commencement, les lecteurs de Prigent ce réjouiront de la publication de Rien qui porte un nom quiregroupe une série d’essais sur des artistes contemporains (de Daniel Dezeuze à Claude Viallat, enpassant par Mathias Pérez). Ouvrage éclairant, s’il en est, ce recueii apporte une lumière crue sur la peinture d’aujourd’hui autant, d’ailleurs, que sur la poésie.Il est à ranger aux côtés de Ceux qui merdrent ou Une erreur de la nature (P.O.L, 1996).
Christian Prigent
Une phrase pour ma mère
P.O.L
202 pages, 115 FF
Rien qui porte un nom
Cadex
176 pages, 135 FF
Domaine français L’inouï de la langue
décembre 1996 | Le Matricule des Anges n°18
| par
Thierry Guichard
Trois livres de Christian Prigent sortent quasi-simultanément. Chacun tente de creuser la langue (la peinture) pour trouver un accès au monde.
Des livres
L’inouï de la langue
Par
Thierry Guichard
Le Matricule des Anges n°18
, décembre 1996.