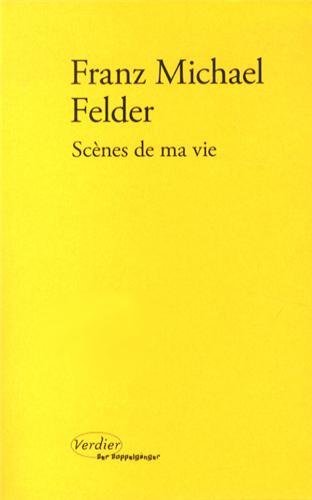Je me rappelle le vif enthousiasme que souleva en moi la toute première lecture, voici deux ans, de Franz Michael Felder (1839-1869), la découverte de cet écrivain dont je ne savais à peu près rien, sinon qu’il avait été paysan, poète et réformateur social, qu’il nous laissait deux romans, Sonderlinge et Reich und arm, une correspondance très abondante et surtout une autobiographie inachevée, Scènes de ma vie, que des auteurs contemporains tels qu’Arno Geiger et Peter Handke plaçaient aussi haut qu’Anton Reiser (K.-P. Moritz) ou Henri le vert (G. Keller), tout en soulignant l’irréductible singularité de l’œuvre et du destin d’un homme qui devint écrivain sans cesser jamais d’être paysan, s’efforça de déceler et de faire fructifier ce que les deux mondes, celui de la terre et celui de l’esprit, pouvaient offrir de meilleur.
Car l’écrivain Felder est avant tout un paysan de Schoppernau, petit village niché au fond d’une des vallées les plus reculées du Bregenzerwald, dans le Vorarlberg, en Autriche, aux confins de la Suisse et de la Bavière. La vie y est rythmée par les saisons, les caprices du relief et du climat, gouvernée tout entière par la nécessité de s’adapter sans cesse, de faire pleinement corps avec la nature et de tourner en avantage ce qui paraît être contrainte. C’est dans ce monde à part, isolant et protégeant ceux qui s’y réfugient, que Felder aura passé toute sa vie, et son écriture, patiente, obstinée, charnelle, porte l’empreinte profonde de cet environnement. Rarement un être aura été à ce point le produit d’un sol, et c’est en paysagiste inspiré, presque en cinéaste qu’il laisse se déployer la terre natale sous nos yeux, avec une variété de rythmes, de mouvements et de perspectives infinie : aux grands panoramiques de certaines ouvertures de chapitres – le regard y court à flanc de rocaille, balaie l’étendue des alpages d’estive, se glisse au creux des combes – se succèdent des plans fixes sur des objets, tel visage, certains gestes de brodeuse, de tisserand ou de charron, puis ce sont de longs plans-séquences dans des intérieurs paysans, à l’occasion de fêtes populaires ou d’offices religieux. Dans ces petites scènes de genre, l’écrivain garde toujours pour décrire ses semblables la bonne distance, celle qui sait rendre pleinement justice aux êtres, sans les embellir ni les transfigurer.
Felder n’oublie pas en effet qu’il fut longtemps, lui le Sonderling, l’original, le jeune homme épris de justice et de liberté qui n’aimait rien tant que s’isoler pour faire retraite en soi et fut le premier garçon de son village à s’abonner à des journaux, en proie aux attaques et aux moqueries de ses contemporains. Pendant les longs loisirs de l’hiver, Felder travaille comme brodeur, fabricant de bardeaux, négociant en peaux pour pouvoir faire venir de librairies toujours plus lointaines les ouvrages qui stimulent son imaginaire : la Messiade de Klosptock, les poésies de Goethe et de Schiller, le Sur la solitude de Zimmermann. Le chemin est encore long, pourtant, qui le mènera de ces textes nourriciers à la pleine conscience de sa vocation : être un écrivain issu du peuple et œuvrant pour le peuple, en son sein même, tout attaché à en évoquer les tourments et les luttes.
L’écriture de Felder est à l’image de ce cheminement intérieur : dense, contrastée, pétrie de doute et d’espérance. De là le côté processuel de la phrase feldérienne, animée d’un double mouvement un peu tremblé qui va toujours de l’extérieur vers l’intérieur et retour. Tout part d’une image, d’un son, d’une impression fugitive et se prolonge instantanément en harmoniques intérieures. La matière de chaque mot se double de l’ombre des idées que le narrateur se fait relativement aux gens, aux paysages, aux atmosphères qu’il décrit. La sensation précède toujours la réflexion et la façonne (on songe ici aux premières lignes des Confessions : « Je sentis avant de penser : c’est le sort commun de l’humanité. Je l’éprouvai plus qu’un autre ») – et l’autoanalyse, l’introspection, si fondamentales chez Felder, procèdent toujours de l’impression physique, de la chose vue – c’est le regard qui guide le cerveau, et non l’inverse. L’écriture y gagne en justesse, en malléabilité, et la tâche du traducteur, à mes yeux, consistait précisément à restituer cette plasticité en français.
De tous les textes sur lesquels j’ai pu travailler ces dernières années, Scènes de ma vie est sans doute celui qui aura le plus éveillé en moi cette joie et cet appétit de vivre que font naître en nous la conscience de la beauté du monde. Comme pour Berlin Alexanderplatz, j’ai travaillé en deux temps. Il m’aura fallu me plonger dans l’univers montagnard et paysan du XIXe siècle, approfondir ma connaissance du lexique des fromagers, des alpagistes, des bergers. Pour trouver des équivalents français aux termes dialectaux assez nombreux qu’employait Felder, j’ai beaucoup emprunté au vocabulaire propre à certains écrivains dont l’univers me semblait parfois assez proche de celui de Felder (Ramuz, ou le Giono du Roi sans divertissement, que je relisais beaucoup alors).
Afin de rendre au plus près la scansion de la phrase de Felder, il était nécessaire de laisser le texte imprégner mon existence même – pendant ces mois de traduction, les journées furent souvent semblables dans leur organisation : à une première lecture annotée succédait une longue marche où s’élaborait une première configuration purement mentale de la traduction, avant l’écriture proprement dite, le plus souvent de plein vent, sur des petits carnets sans marge, d’une seule coulée et sans rien retoucher – le soir étant consacré aux corrections, repentirs et infléchissements, à la lecture et au visionnage d’œuvres qui me semblaient entretenir des affinités souterraines avec le récit que je traduisais et qui, prolongeant l’atmosphère poétique de la journée, me permettaient d’entrer de plain-pied dans celle du lendemain. Ce rôle fut dévolu cette fois aux Confessions, à certaines ébauches autobiographiques de Benjamin Constant, aux films de la première période parlante de Renoir (Toni, en particulier), et à la merveilleuse Maison des bois de Pialat, dont la douceur tempérée d’âpreté entrait si bien en résonance avec le monde de Felder.
J’envie ceux qui liront pour la première fois ce texte lumineux et secret, et j’espère qu’ils retrouveront dans notre langue un peu de sa verdeur originelle. Relisant ces jours derniers les épreuves définitives de ma traduction, je m’émerveille une fois encore que la prose d’un jeune paysan vivant esseulé au fond d’une vallée encaissée du Vorarlberg possède une telle rémanence et un tel pouvoir d’envoûtement – et qu’une œuvre à ce point personnelle et singulière puisse avoir une portée aussi universelle.
* Traducteur, entre autres, de Peter Handke, Alfred Döblin, Arno Geiger. Scènes de ma vie paraît en février aux éditions Verdier.
Traduction Olivier Le Lay
janvier 2014 | Le Matricule des Anges n°149
Scènes de ma vie, de Franz Michael Felder
Un livre
Olivier Le Lay
Le Matricule des Anges n°149
, janvier 2014.