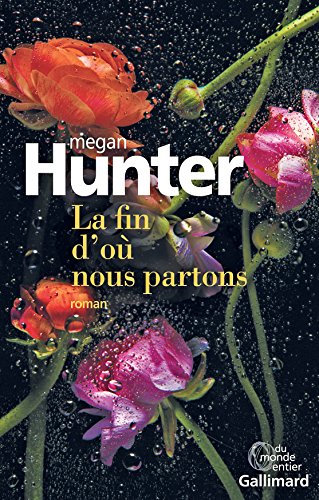Il faudrait d’abord parler de cette voix, de la manière avec laquelle elle aménage, dans l’espace mental du lecteur, une chambre intime avec vue sur l’origine du monde. Comment, par petites touches, parfois énigmatiques, elle tisse une histoire de naissance et de guerre, d’apocalypse et d’errance. Comment la narration poreuse en diable donne à voir ce qui n’est pas dit. Comment elle se nourrit de sensations, détails infimes, phrases jamais entendues ou lues. Mais il faudrait dire, dans le même temps, combien cette histoire est puissante. Raconter ce qui n’est pas écrit et qu’on a lu pourtant : un couple à Londres attend un enfant alors que la ville est livrée aux eaux, que la catastrophe s’annonce. Comment, l’enfant venu au monde, il faut à ces trois-là fuir le déluge, la panique, la guerre qui couve. Dire en peu de mots leur retraite chez les parents à lui, la nourriture qui commence à manquer, les expéditions pour aller en chercher. Évoquer la disparition de la grand-mère piétinée peut-être dans une émeute alors qu’elle était avec son mari et son fils, le père de l’enfant. Puis la disparition des deux hommes, qui laissent la jeune maman seule avec son fils et des tiroirs vides de provisions. L’attente. L’enfant qui cherche les seins de sa mère, leurs deux corps couchés dans l’herbe, l’attente, la disparition du père pendant plusieurs jours, qui finit par revenir, seul, témoin de quelles scènes d’horreur. La fuite ensuite de la petite famille pour un camp de réfugiés et l’espèce de cancer mental que le père a ramené de ce qu’il a vécu et qu’on ne sait pas. L’enfant et sa mère, l’un à l’autre soudés, chair à chair, odeur contre odeur. La disparition à nouveau du père, enfui, perdu, rongé. L’errance de la mère et de l’enfant, d’un camp de réfugiés l’autre, la découverte d’autres mères avec enfant et sans mari. Un bateau sur la mer qui prend la narratrice et son enfant pour les sauver. Une poignée de Robinson naviguant sur les océans, débarquant sur une île. La première dent du bébé, ses gestes, le nez de la mère dans le cou du gamin.
Et puis il faudrait, toujours en même temps, évoquer ces courtes bribes de textes mythologiques qui viennent ponctuer le récit fragmenté, qui viennent s’y agglomérer avec une homogénéité sensible : « En ce temps-là, des gens vivaient sous terre. Ils commencèrent à sortir un par un, en s’accrochant à une longue et solide corde. » Des textes d’une genèse qui accompagne l’enfant dans son apprentissage sauvage et instinctif de la vie.
Aucun des personnages du livre n’est nommé autrement que par une lettre : R, le père, Z l’enfant, H le Robinson, etc. Comme si la romancière redécouvrait ainsi, à partir des lettres de l’alphabet, la naissance de l’écriture.
Si l’histoire rappelle un peu celle de La Route de Cormac McCarthy ou le très beau Dans la forêt de Jean Hegland, l’écriture de Megan Hunter (née en 1984 à Manchester) use d’une poétique qui renvoie le lecteur français aux premiers livres de Nathalie Quintane, dans le saisissement du quotidien. Ainsi lorsque R quitte la narratrice : « Je regarde la voiture avant de la perdre. J’essaie d’en assimiler le moindre détail. Avant qu’il s’en aille, je pose sa main à plat sur mon visage, comme un masque. Je fais ça même si cela ne sert à rien. Même si on ne peut retenir les odeurs. » Mais on pense aussi au Tiroir à cheveux d’Emmanuelle Pagano dans la sensualité brute qui se dégage du rapport à l’enfant : « Z a une baignoire désormais, et une chambre. C’est un vrai garçon, je pense. Ce n’est plus un pantin que l’on traîne dans le chaos. Il a une forme. »
Tissé d’annotations, de phrases sorties de la nuit des mots, empli de sensations, d’émotions retenues, le roman finit par grossir en nous, plein de ce qu’il ne dit pas, qu’on entend comme on entend, l’oreille collée à un coquillage, la rumeur d’une mer plus vieille que l’humanité.
On en sort ébloui, revigoré d’avoir traversé en si peu de pages, l’expérience de venir au monde.
T. G.
La Fin d’où nous partons, de Megan Hunter
Traduit de l’anglais par Aurélie Tronchet
Gallimard, 169 pages, 16,50 €
Domaine étranger Naissance d’un auteur
mars 2018 | Le Matricule des Anges n°191
| par
Thierry Guichard
Dès son premier roman, la jeune Megan Hunter affirme une voix singulière et radicale pour donner à entendre la genèse du monde que chacun porte en soi. Époustouflant.
Un livre
Naissance d’un auteur
Par
Thierry Guichard
Le Matricule des Anges n°191
, mars 2018.