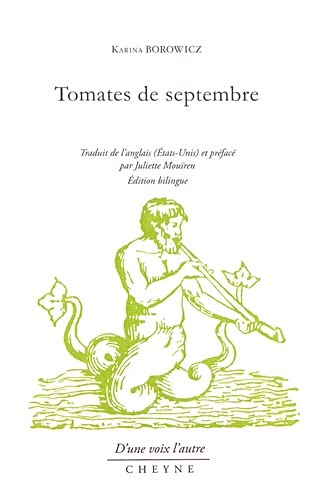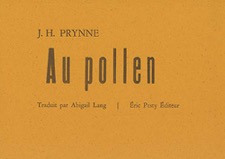J. H. Prynne et Karina Borovicz, deux auteurs magnifiquement découverts par des éditeurs indépendants, partagent depuis leur langue natale ce souci de la rendre étrangère à elle-même. C’est-à-dire d’en faire le lieu d’une violence et de la traduire.
Viser le langage comme une mécanique de pointe, travailler à la loupe les mots comme une véritable matériologie, n’est pour eux deux que le revers d’une attention portée à ce qui, du fond des océans à la moindre surface du réel, vient former la violence devenue incommensurable du monde. D’une bactérie fabriquée dans un tube à essai, propre à contaminer un continent entier, aux codes qui échelonnent les colonnes spéculatives de l’économie, de l’aboiement d’un chien dérivant sur un bloc de glace au large d’une baie, à un homme tentant de décongeler son frère, il y a le chas d’une aiguille par quoi passe ce que ces deux poètes tentent de dire. L’usage qu’ils font du langage pour en faire leur langue, singulière, revêche, hardie, est aussi façonné par un élan prosodique d’une simplicité parfois désarmante, notamment chez Karina Borowicz. L’une et l’autre tournent le dos à tout didactisme, comme à toute naïveté béate.
Les éditions Pesty publient avec Au pollen le troisième livre du poète anglais J. H. Prynne (né en 1936), représentant de ce que l’on a appelé le British Poetry Revival. Six de ses « chapbook » seront publiés dessinant sur plusieurs décennies les questionnements de cette poésie. Prynne conçoit ici un livre de 22 strophes de 12 vers, dont la langue, parataxique, les ellipses comme la multiplicité des vocabulaires (technique, économique, scientifique, pragmatique, etc.) se conçoivent comme une guerre contre une autre (celle d’Irak 2003-2008). Austérité, énigmatiques torsions langagières, forment une basse sonore stupéfiante que sa traductrice, Abigail Lang, restitue avec un tour de force impressionnant : « Résolution affligée ils hèlent nous les coupons à leur tour ils longent la route refusée, la tenant au plus. (…) Parents sortis de la crise symbolique détruite, une ligne après l’autre élevée pour casser maniaques laissés-pour-compte intubés ». L’effort porté sur la syntaxe, le rythme, la justesse des choix lexicaux, ouvre dans le langage des biais par lesquels s’éclairent des pans diffractés de réalités non-vues, voire inouïes.
Karina Borowicz, née dans les années 60 dans le Massachusetts, n’a publié aux États-Unis que deux livres. Tomates de septembre suivi d’un choix de Preuves révèlent pourtant une voix nouvelle de la poésie américaine. Débarrassée de toute influence post-moderne, voire de jeux formels, Borovicz élabore de véritables poèmes-monde. L’héritage assumé et revivifié de l’objectivisme (de William Carlos Williams aux poètes du Black Mountain College) y est déplacé vers un lyrisme à voix basse. Le moindre geste est scruté, du travail des femmes il est écrit « la nuit leurs doigts raidis libèrent les épingles/qui tiennent leurs chignons bien en place/laissant les tresses d’argent se dérouler/le long de leur dos comme de la corde décolorée ». D’un autre, que « le visage du pain est soudain/révélé, dans un geste aussi simple/que grand, au moment où l’entame brunie/se détache ». Des exils en Sibérie, qu’un « homme qui possède/un crayon cassé/esquisse les aurores boréales ». Des animaux, qu’ils portent l’indifférence sans nom de l’espèce humaine dans leur propre silence, le regard des cerfs, « L’œil effarouché du cheval/lorsque j’étends mon visage contre son encolure en sueur ». Ceux qui n’ont pas de mots sont au centre, comme la plupart des choses et des êtres qui se logent dans les poèmes de Karina Borowicz.
Une Amérique d’aujourd’hui, entre chien et loup, dans des campagnes perdues, comme celle que filme Kelly Reichard, apparaît ici, plan séquence tendu vers presque rien : « les arbres alentour/sont vides d’oiseaux/habiles dans l’art de prédire la violence//Un des hommes/décharné dans ses épais vêtements/vient d’une île/lointaine ».
Emmanuel Laugier
Tomates de septembre (bilingue)
Karina Borowicz
Traduit de l’anglais (États-Unis) et préfacé par Juliette Mouïren
Cheyne, « D’une voix l’autre », 172 pages, 24 €
Au pollen
Jeremy Halvard Prynne
Traduit de l’anglais par Abigail Lang
Éric Pesty, 26 pages, 11 €