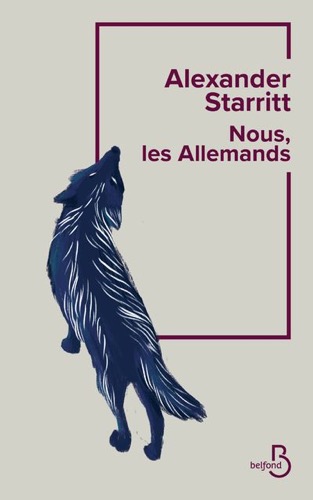Enrôlé dans la Wehrmacht au sortir du lycée, Meissner participe à l’opération Barbarossa puis survit au front de l’Est, avant d’être fait prisonnier en 1945. Lorsque des années plus tard il commence à relater ces faits, le présent est si éloigné de l’époque de la guerre qu’il paraît inimaginable d’avoir pu vivre les deux. Pourtant, les sons, les odeurs, les sensations de ces années resurgissent au milieu de sa vie bucolique de retraité. La faim par exemple, qui vous prend au corps, « comme si vous sentiez vraiment les cellules de vos muscles se désintégrer ». C’est ainsi que l’on entre dans ce roman de guerre : par des souvenirs sensoriels, sous la peau.
De toute cette guerre, Meissner ne raconte que quelques journées de l’automne 1944, « alors que la guerre était presque perdue et notre désintégration mentale, physique et morale, presque complète ». En marge d’une armée délitée, avec quelques camarades, il se retrouve acteur de deux épisodes paradoxaux : d’abord la trahison lorsqu’ils attaquent leur propre police militaire pour piller un entrepôt de vivres ; puis l’exact opposé, lorsqu’ils entreprennent de bloquer l’avancée d’une unité russe vers d’autres membres de cette même police nazie. Une nuit sépare les événements, pendant laquelle ils festoient tristement dans les bois, conversent, ont peur les uns des autres, tombent hors du réel.
Nous, les Allemands se résume en une question : que pouvait faire un individu allemand livré à lui-même quelque part en terre polonaise en 1944, dans des circonstances où l’avait porté toute une nation ? Le temps du récit est entrecoupé de réflexions, de digressions, d’accélérations puis de retours en arrière. Cet agencement cahin-caha, fragmenté, manifeste déjà la débâcle en cours. Mais cette forme, qui se gonfle d’émotions au fil des pages, figure bien d’autres choses encore. L’oscillation entre l’inconnu de l’horreur et la familiarité de la civilisation qui l’a produit, les va-et-vient de questionnements moraux infinis, la rencontre entre responsabilités individuelle et collective. Incantatoire, l’écriture assurée d’Alexander Starritt, traduite avec une magnifique fluidité par l’écrivaine Diane Meur, parvient à dire de façon grandiose mais non épique la folle mégalomanie du front de l’Est, son immensité qui ressemblait en soi à un abîme moral : « envahir la Russie, c’était comme déclarer la guerre à la mer ; elle nous a tout simplement avalés ».
Au moment du récit, l’armée allemande en débandade ne connaît plus de spécialisations et le brassage social devient total. Meissner se retrouve avec un docker, un éditeur, un petit-bourgeois nazi, un paysan… des Allemands. S’il dit d’emblée qu’il n’a « pas été un Nazi », il ne se désolidarise à aucun moment de ce « nous » allemand, transclasse. Il n’a de cesse d’examiner l’indéfectible lien entre circonstances et individu, de dire et redire que ces crimes sont imputables au « nous » (« Nous avons abattu les piliers soutenant l’édifice de la civilisation ») et d’approfondir ce qu’il nomme l’« antique vérité » : « vous pouvez être coupable d’une chose qui ne dépendait pas de vous. »
Alexander Starritt met en scène non pas une confession mais un moment de transmission. La guerre n’y apparaît pas comme un événement figé dans le passé mais comme une matière sans cesse digérée par le présent. Le destinataire de la lettre, Callum, intervient régulièrement, sous forme de commentaires. Ces coupures, qui figurent une conversation virtuelle entre eux deux, permettent de briser plus encore le rythme de la narration principale, parfois de manière très abrupte. Elles nous font revenir de force dans le présent, de manière à ce qu’apparaisse la persistance des interrogations de Meissner, mais aussi les erreurs du travail de mémoire : Callum accuse les clichés au milieu desquels il a grandi, comme les complexes qui rongent ses contemporains allemands. Comment faire pour ne pas simplement raser le monde de ses grands-parents mais s’en servir « comme on enfouit le trèfle fauché pour enrichir le sol » ?
« Là où il reste de la honte, il peut rester de la vertu ».
Par la fiction, et en s’appuyant sur les moyens propres au récit, Alexander Starritt propose donc un changement de paradigme dans la manière d’appréhender cet héritage. En prenant le point de vue inhabituel de l’envahisseur et du vaincu, à la façon des Perses d’Eschyle. En représentant un dialogue entre les générations. En proposant, surtout, de substituer à la culpabilité la honte, pour laquelle il n’y a pas de réparations possibles, dans l’espoir que « là où il reste de la honte, il peut rester de la vertu ».
Inspiré par l’histoire de son propre grand-père, ce deuxième roman d’Alexander Starritt (le premier traduit en français) impressionne par la singularité et l’amplitude de son point de vue. Son personnage quasi autobiographique d’écrivain anglais de la troisième génération permet un recul qui ne soit ni celui d’un théoricien ni celui du témoin qui cherche à enjoliver son vécu. À travers l’histoire familiale de Callum, ce Londonien du XXIe siècle, son héritage devient métaphoriquement celui de tous les Européens.
Ce qui frappe enfin dans Nous, les Allemands, écrit en 2020, c’est le chemin parcouru depuis des textes comme Le Cheval rouge d’Eugenio Corti ou Kaputt de Curzio Malaparte, plus proches des événements et pourtant plus lointains tant le romanesque plein et les velléités idéologiques ou esthétisantes prennent le dessus. La démarche d’Alexander Starritt rappelle celle de Charlotte Delbo ou Svetlana Alexievitch, en offrant le simulacre d’un témoignage humain, imparfait et irrégulier, un flux de conscience sans cadrage narratif précis. Chaque phrase de Nous, les Allemands donne la sensation d’une matière vivante, mouvante, à l’encontre de toute fossilisation et signale un roman pour l’avenir.
Feya Dervitsiotis
Nous, les Allemands
Alexander Starritt
Traduit de l’anglais par Diane Meur,
Belfond, 208 pages, 20 €
Domaine étranger Digérer le passé, encore
septembre 2022 | Le Matricule des Anges n°236
| par
Feya Dervitsiotis
Lettre posthume d’un soldat allemand du front de l’Est à son petit-fils anglais, Nous, les Allemands est un récit de guerre aussi insolite que profondément nécessaire.
Un livre
Digérer le passé, encore
Par
Feya Dervitsiotis
Le Matricule des Anges n°236
, septembre 2022.