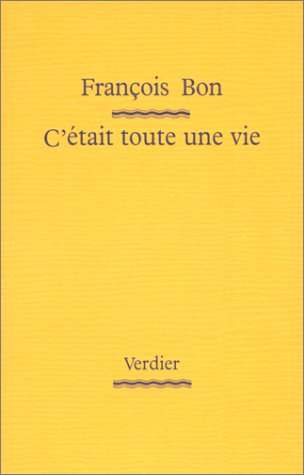La plupart du temps dans C’était toute une vie, le narrateur ce n’est pas « je » ou « il », c’est « on ». Un « on » qui hésite entre je et nous, qui héberge pas mal de « eux » aussi, comme si celui qui parle, ne parlait finalement qu’à partir de l’expérience des autres, comme s’il n’était que le réceptacle de leur vie, ou plutôt de ce qui lui est possible de comprendre de leur vie. « On », donc, regarde, observe, essaie de sentir avant de comprendre. Quoi donc ? La vie telle qu’elle se déroule mal dans les petites villes où il va, pélerin, proposer des ateliers d’écriture : « Pour soi-même on se contente de venir à Lodève le jeudi. Mais on y trouve des êtres pour qui il faudrait une autre dimension du monde. » Ce narrateur-là est comme François Bon : il se coltine avec une misère à faire pâlir d’envie les producteurs d’émissions télévisées. Et ceux dont il est ici question, pourraient jouer dans les théâtres d’ombres des romans de Jacques Serena. Marginaux, épaves que la vie rejette vers les banlieues, les villes en cul-de-sac, dealers d’héroïne parce que consommateurs, victimes simplement. Mais ils sont si semblables, ces personnages de roman, à ceux que l’on n’aime pas croiser parfois dans les villes que l’éditeur et l’auteur ont tenu à préciser, comme « avertissement » en début d’ouvrage, que « Ce livre est une fiction, les propos prêtés aux personnages, ces personnages eux-mêmes, et les lieux où on les décrit sont en partie réels, en partie imaginaires. » Précaution nécessaire encore que, à lire la prose de François Bon, il ne fait aucun doute que l’ouvrage appartient à la littérature et non au témoignage même si l’émotion qu’elle fait naître, elle, est bien réelle. Et il est étrange de sentir qu’il faudrait, pour parler de cette émotion, convoquer les mots comme « rudesse » ou « âpreté ». Une émotion douloureuse dans laquelle entre pas mal de rage.
C’est d’abord dans les paysages, dans ces descriptions qui ne laissent guère de place à l’enthousiasme des guides de tourisme, qu’elle s’inscrit. Et d’abord le cimetière où repose celle autour de qui le livre tourne, et où « la terre ingrate et métallique rejette des fragments d’os rougis comme la terre, tibias, bouts lisses de crâne. (…) En marchant, par réflexe, les os on les évite. ».
Et ces os qui affleurent en surface, ce sont un peu les signes de ce qui se joue dans le livre, la reconstitution d’une vie, celle de cette femme de 32 ans dont le narrateur possède en tout et pour tout 23 pages d’écritures phonétiques, violentes qui ne suffisent pas à constituer « toute une vie ». De même, les témoignages de sa sœur, de ses amis (dans l’ambiance des cafés où les flippers appellent les buveurs de vin blanc) tâtonnent à la recherche de la disparue. « On se saura pas, parce qu’on n’est pas allé où, elle, elle est allée » et plus loin, cette phrase sur laquelle se fonde le livre : « les livres sont malades, et eux, qui vont dans l’abîme, savent réveiller la langue du monde. » Comme si dans la descente au plus profond de soi où s’élabore l’écriture, ces gens-là qui viennent aux séances d’écriture, avaient plongé plus loin, et depuis plus longtemps, que l’écrivain. Au point que ce qui leur manque, et ce pourquoi ils sont là, le jeudi, c’est de pouvoir remonter à la surface les mots qui permettraient peut-être d’accéder au monde, des mots qui rendraient possible le partage. Ainsi, la jeune morte, laisse-t-elle trois feuilles au narrateur « glissées sous la porte de la bibliothèque un soir après la fermeture. Elle avait aussi écrit, explicitement : « tu sais ecrire tu me comprend fait un Article. pour lodeve pour moi. pour le Mal que jai. »
Et de ces quelques personnes qui fréquentent l’atelier d’écriture à Lodève « dans l’Hérault, sept mille habitants et cent vingt maisons à vendre », le narrateur nous donnera à lire quelques unes de ces fulgurances, qui certes font de fortes images, mais ne réussissent pas à faire de la littérature. Phrases jetées sur des feuilles de publicités dont regorgent les boîtes à lettres, ou dictées à la bibliothèque quand on ne sait pas écrire. Disons-le tout de suite, ce n’est pas là, dans cette démonstration de l’immense sensibilité de ces écrits, que C’était toute une vie nous touche.
Ce qui bouleverse, c’est l’acuité avec laquelle le narrateur porte son regard sur toute une ville, la violence avec laquelle il montre le massacre des »âmes« (quel autre mot ?) auquel se livre notre siècle. En construisant une topologie autour de lieux symboliques (le Panorama où la ville apparaît en trompe-l’œil, le bar La Citadelle où la patronne essuie ses verres et recueille de lourds secrets, le monument aux morts, où les statues de femmes représentent plus celles qui s’épuisent aujourd’hui dans la ville que celles qui pleurèrent leur mari, leur fils), François Bon nous accule à ressentir l’immense gâchis humain à partir de quoi se développent, d’un côté les autoroutes qui filent vers la mer, de l’autre, les maisons sans toit où s’échange la même seringue. Et c’est vrai que pour dire cela, la littérature sera toujours plus nécessaire que les journaux. Il suffit au narrateur de feuilleter les articles parus dans La Dépêche du midi et conservés à la bibliothèque, pour comprendre que ce langage qui parle de « changements à la Poste », d’ « opérations brioche » pour les enfants inadaptés » ne saurait être compris de ceux qui écrivent, par exemple : « et le souvenir comme un rêve se débat dans un tambour, j’ai peur mère j’ai peur, trop de terreurs dans les ombres (…) ».
En fin d’ouvrage, dans un incessant questionnement sur cette femme qui préféra quitter la vie que continuer à lutter avec ses trois enfants, le narrateur en vient à une saisissante comparaison. Se souvenant de lectures sur la découverte du pôle Sud, ressuscitant les figures des explorateurs partis à la recherche de « taches blanches à prendre, qui exigent de soi l’extrême », rappelant que le commandant Scott, en 1909, est enfin parvenu à atteindre le pôle (après combien de souffrances ?) mais qu’une fois arrivé, il a découvert qu’un autre l’avait devancé, c’est bien sûr à elle, la morte, qu’il pense, ce sont à eux, ces figures d’ateliers d’écriture, qu’il compare les explorateurs du début du siècle. Et s’il devait lui aussi se donner le destin de l’un d’entre eux, ce serait celui de Scott, découvrant, au plus sombre de son voyage, que d’autres déjà, sont passés par là.
On reprochera à François Bon, de donner une image un peu trop romantique de ces « humbles », de les élever un peu trop au-dessus de lui. Il ne suffit pas de toucher le fond de l’océan pour être un bon plongeur, il faut savoir aussi remonter à la surface. Ça, l’écrivain y parvient. Et si ce qu’il nous ramène de visions enfouies a de quoi nous effrayer, c’est que son livre, alors, était nécessaire.
C’était toute une Vie
François Bon
Verdier
140 pages, 75 FF
Domaine français L’exploration d’une vie
Dans une ville de l’Hérault, une mère se suicide. Elle suivait un atelier d’écriture avec un écrivain qui va chercher à reconstituer la vie de la jeune femme. C’était toute une vie ou la plongée en eaux profondes.