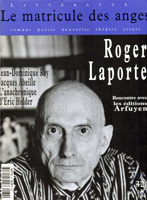Quelques personnes s’attardent encore près du portail. Le prêtre est déjà parti ; les fossoyeurs, du tranchant de leur pelle, égalisent la terre avant de déposer fleurs et couronnes sur la tombe. Une cousine germaine a reçu les condoléances, le père trop âgé n’était pas là. A-t-il seulement compris que sa fille était revenue au village ? Au matin, le corps a été ramené de l’Hôpital Spécialisé, ici on ne dit pas asile d’aliénés ou hôpital psychiatrique- un ultime trajet après tant d’aller-retour.
Je l’avais croisée ici même, un été, il y a deux ou trois ans. Au détour d’une allée, elle avait surgi devant moi, ombre massive et noire. Tu me reconnais ? Ma promenade matinale m’avait conduite jusqu’à ce cimetière aux tombes serrées autour d’une église de campagne. Annie. Aussitôt ressurgirent ces sentiments mêlés de pitié et d’agacement, d’ennui et de mépris que nous avions eus pour elle. Me revint le souvenir d’une photo carrée en noir et blanc, prise à la fête de B. : les filles assises en amazone à l’arrière des mobylettes, les mains sagement posées sur les épaules d’un garçon souriant à l’objectif ; France, la blonde, ma complice, Marie-Laure, la sérieuse, son aînée, Christian dont les mains tremblent quand nous dansons ensemble, les jumeaux J.P. et J.L. Mado est encore là, Mado la rieuse. À l’écart, Annie, assise sur le parapet d’un pont nous regarde.
Avec le temps, ses traits avaient acquis un peu de douceur, le temps estompe la laideur comme les souvenirs. Elle parlait lentement, avec application ; à la commissure de ses lèvres, une écume blanche. Un horrible tic projetait sa langue hors de sa bouche à chaque inspiration. Viens prendre le thé, dit-elle. J’improvisai une excuse, tentai de m’éloigner mais elle insistait, inventoriant nos occupations de ces lointains étés : tricot, couture, sablés, tarte au citron. Pendant la semaine, nous nous réunissions chez l’une ou l’autre, les filles seulement. À peine sorties des jeux de marelle, nous préparant déjà au mariage. Elle, nous ne faisions que l’accepter. Dans ce village au bout de la route, les cousinages tressaient un réseau solide que notre indifférence ne pouvait rompre. Sur le Teppaz, Hervé Villard chantait. Une nappe et des serviettes, point de croix ou point de bourdon, initiales entrelacées, Mado riait, Mado brodait. Mais de Mado, elle ne parla pas.
C’est le printemps, dimanche des Rameaux.
Ma grand-mère me l’a annoncé au retour du village où, avant la messe, elle est allée chercher le pain du déjeuner. Sans doute se mouchait-elle, ponctuant son récit de Ma pauvre Mado… Ce pauvre garçon…. Elle disait ce car il n’était pas du village. Dehors, le ciel hésite entre dernière averse de neige fondue et rayon de soleil. Au-dessus de la cheminée, le miroir est tavelé par l’humidité. Je me regarde être émue, je me regarde pleurer. Ils l’ont trouvée assise près de lui, mort. Il s’appelait Pierre. Les parents de Mado les attendaient pour dîner, un dîner encore un peu solennel ; ils sont fiancés depuis quelques mois, la date du mariage est fixée, ce sera en juin. La soirée s’avance, on a mis la soupe au chaud au coin de la cuisinière à charbon. Je les imagine, les parents et les frères aînés, tentant de contenir l’inquiétude croissante. Mais l’évidence finit par s’imposer : tant d’autres ont perdu la vie sur cette route accrochée à flanc de rochers, qui descend des hautes terres arides où il est né. Tout à coup ils se décident. Devant le miroir, je pleure. Je les vois le père, les frères, un cousin et un oncle aussi, rien que les hommes. En silence, ils remontent le lit du ruisseau ; les faisceaux de leurs torches s’accrochent aux rochers, aux herbes courtes, aux arbres dénudés. J’entends leur respiration ; la marche est difficile, les galets roulent et claquent sous leurs pieds. Combien de temps marchent-ils ainsi en silence avant de l’apercevoir, la lueur fugace de ses yeux dans le balayage hésitant et heurté des taches de lumière puis saisie, stupéfaite. Pleure-t-elle ? Je n’imagine rien d’autre, pas de blessure, pas de sang, elle est assise à côté de lui et je ne sais pas si elle pleure. Je ne peux qu’aller au-delà, à l’heure où les maisons s’allument. Ils reviennent de l’hôpital, soulagés -Mado vit- et honteux de l’être car Pierre est mort ; muets sans doute. Ils l’ont laissée, le regard vide sous l’effet des sédatifs, dans le halo blafard de la veilleuse. Ils entendent encore les ordres précis des pompiers, des médecins, leur sollicitude, ils revoient sa main à elle qui s’est attardée quelques secondes sur les galets du ruisseau, là où il était resté allongé. Le père pense à la mère qui les attend ; elle voudra aller auprès de Mado, veiller sur son sommeil, prise elle aussi entre le soulagement et la douleur à partager. À l’heure où les maisons s’allument, ils reviennent. Dimanche des Rameaux. Dans les cuisines silencieuses, les gestes s’enchaînent : verser les boulets de coke après avoir froissé les journaux, ouvrir la trappe du conduit de cheminée, embraser les papiers, remettre en place les rondelles de fonte. Les hommes, ce matin, ne vont ni dans les champs ni dans les vignes ; juste remplir de fourrage les mangeoires et préparer les auges des cochons. Avant d’enfiler leur chemise blanche, ils se raseront. Les femmes s’occuperont des poules et des lapins. Au dernier moment, elles ôteront leur blouse, passeront un gilet sombre et un manteau, se couvriront la tête d’un fichu ou d’un chapeau noir. La messe est à dix heures. Quand les cloches sonnent, ils sont là, groupés devant le porche de l’église, les hommes d’un côté, les femmes de l’autre tenant dans la main une branche de buis pour la bénédiction. Au hochement des têtes, les retardataires devinent qu’un malheur est arrivé. L’office bruisse de chuchotis et de soupirs. À la fin de son homélie, le curé dit quelques paroles invitant à partager l’affliction des parents. Les larmes viennent aux yeux des femmes. Les hommes se raclent la gorge.
Quand l’été revient, les mains de Mado restent désœuvrées sur ses genoux ; disparus les nappes à broder et les cotons de couleur, disparues les photos de fiançailles. Intimidées par son chagrin, nous lui rendons visite avec un sentiment de pitié et d’obligation, gênées, maladroites, étouffant notre gaieté, notre insouciance. De longs silences traînent dans nos après-midi. Des questions nous obsèdent : pleurait-elle, que se sont-ils dit, comment a-t-elle compris qu’il était mort ? Aucune n’ose le demander mais chacune, dans ses rêveries à l’orée du sommeil, s’imagine être la fiancée en deuil, la jeune promise au bonheur détruit. À regarder Mado en robe noire, un mouchoir à la main, assise dans son fauteuil d’osier le pied posé sur un pliant, naît une envie ténue et inavouable. Toutes nous rêvons d’être l’héroïne d’une histoire, une de ces histoires à deux sous, romans-photos dérobés à une tante ou une grand-mère que nous lisons en douce. Plus que nous sans doute, rêve Annie.
Chaque dimanche, elle s’apprête pour se rendre aux fêtes votives avec nous et quelques garçons du canton. Au bal, les garçons entament quelques tours de pistes, le cou tendu, le regard à l’affût ; les plus réservés se dirigent vers la buvette. Nous, les filles, restons groupées dans l’attente d’un inconnu ou d’un soupirant aguiché les dimanches précédents. Nous nous rêvons citadines mais toutes nous savons que, ville ou campagne, le mariage décidera de notre sort. Elle, la moche, oscille entre la crainte et l’envie d’être abordée. Elle a mis sa jupe jaune à godets. C’est la mode, a dit la vendeuse. Sans doute, mais les quatre pans évasés et la couture médiane soulignent la grosseur de son ventre ; elle serre les abdominaux quand elle y pense. D’elle, certains disent qu’elle fut une enfant comblée. Des cousines, des tantes. Pensez-vous, fille unique, elle a été gâtée. Elle s’interroge sur ce mot, comblée. Ces vieilles papoteuses, savent-elles que son enfance s’est arrêtée un premier octobre, à douze ans, quand le car de sept heures la conduisit en pension. Son enfance fut comblée, oui, comme le talus devant la maison, enseveli sous les gravats et les rochers, nivelé puis scellé d’une terrasse de béton sur laquelle fut construite la longue bâtisse d’un poulailler. Le talus, son territoire, qu’elle dévalait en s’accrochant aux genêts pour arriver plus vite à l’école du village, où elle venait s’allonger, face au ciel, à l’insu de tous, pour surprendre les étoiles filantes des nuits d’août. Une enfance scellée quand la porte du collège s’est refermée. Est venu le temps du corps qui change, saigne et s’alourdit, du corps honteux qui se barricade de graisse. Elle l’a vu dans nos yeux, elle le voit dans son reflet, inscrit dans les mots des autres… une fille solide… une fille plantureuse… elle tient de sa mère ; de sa grand-mère surtout dont elle garde le souvenir d’une carnassière, une charpente d’os et de chair lourdement plantée dans la terre, des cheveux crépus poivre et sel qu’un chignon serré sur la nuque n’arrivait pas à maîtriser, un visage lourd au nez droit et large dont les narines charnues étaient curieusement mobiles. De sa mère, elle a oublié l’odeur de la chair, le grain de la peau, la douceur des seins ; elle ne voit que la blouse tendue sur le corps massif et droit, trois blouses en réalité, identiques et différentes, semis de fleurs sur fond bleu ou noir, alternant au fil des jours et des saisons. Plus tard, bien plus tard, malgré son refus, ce qu’elle tient d’elles se sera inscrit dans son corps, la façon de pencher la tête, la cadence lourde de la marche qu’interrompt une sorte de pas glissé quand elle se dépêche, l’habitude de frotter l’index contre le pouce et de lisser sa jupe sur ses hanches. Mais il n’est pas encore temps.
Elle a dix-huit ans et elle attend. Nous, ses camarades, disparaissons les unes après les autres. Elle nous regarde passer devant elle comme les chevaux de bois d’un manège. Parfois, rarement, un homme s’approche, lui propose de danser. Un vieux au regard allumé par l’alcool. Elle refuse sans un mot, d’un léger retrait du corps, se détourne et se met à errer dans la fête, l’air soudain accaparé. Elle traîne autour du bal, hésite, reste un instant près de l’estrade ; à scruter les visages qui tournoient, elle se sent ivre, comme épuisée. Alors elle s’éclipse, file entre les badauds, les familles endimanchées, les bandes d’enfants qui se poursuivent dans des rafales joyeuses de serpentins et de confettis ; elle s’éloigne de la poussière, des odeurs grasses et sucrées des stands forains, des effluves aigres d’eau de Cologne et de sueur. La fraîcheur, l’air piquant de la nuit la soulagent de l’inquiétude qui la taraude à affronter les regards. La regarde-t-on seulement ? Le plus souvent non. Les yeux glissent sur elle et si parfois ils s’attardent, c’est pire, elle se sent brûlée par les signes fugitifs qui passent sur les visages.
Alain, lui, a patienté. Il est resté près d’elle, attendant qu’elle s’habitue à sa présence, qu’elle ose le regarder. Ni beau ni laid, il est plus petit qu’elle, plus âgé aussi ; ses cheveux sont clairsemés. Souvent, elle l’a aperçu dans la ville voisine avec une bande de copains. Ils portent des blousons et des jeans et se réunissent au café de La Fontaine autour des baby-foot. Les femmes du village quand elles descendent à S. par le car du samedi les observent avec méfiance. À la radio, on parle de blousons noirs. Il lui dira qu’il est fraiseur -elle ne sait pas ce que c’est mais n’osera pas demander. Plusieurs dimanches, il la retrouve, de village en village, d’une fête à l’autre ; il vient à ses côtés, reste le temps d’une danse, s’éclipse, reparaît. Un soir, il lui propose de danser ; elle n’ose pas refuser, elle a presque l’impression de le connaître, il lui est devenu familier. Il l’entraîne au milieu des couples qui se forment, la prend par la taille, sans la serrer de trop près. Malgré cela, elle se sent maladroite, gauche, elle danse si rarement. Elle essaie de se laisser aller, de se laisser mener, mais son corps résiste : chaque fois que leurs pieds se heurtent, elle murmure pardon, ne sachant si elle doit ou non s’excuser. Les trois danses s’enchaînent. Elle a les mains moites. Sans doute n’est-il pas un bon danseur, mais s’en aperçoit-elle ? Quand il la reconduit à la limite du bal, elle le remercie, soulagée, et pourtant immédiatement, elle se demande s’il l’invitera encore. Il ne s’attarde pas. Elle l’aperçoit plus loin avec des copains, riant et cognant leurs verres. À nouveau, il l’invite. À la fin d’une danse, il ne lui lâche pas la main ; il sourit, gentiment lui semble-t-il.
Viens, on va faire un tour.
Elle ne répond pas, ne trouvant pas les mots ; la crainte lui serre la gorge. Il l’entraîne loin des maisons. De part et d’autre de la route, dans les champs moissonnés transformés en parkings de fortune, des murmures, des ombres furtives : d’autres couples s’esquivent entre les voitures. La musique se fait moins violente ; entre les morceaux, elle entend les éclats de voix et de rire, les claquements du tir à la carabine. Alain ne dit rien. Ils longent le haut mur de pierres du cimetière au-dessus duquel on devine l’ombre noire des crucifix. Un talus le prolonge.
On s’assoit un moment ?
Dans l’herbe ?
Sa voix est sourde, il ne semble pas s’en apercevoir. Elle préférerait le banc qu’ils ont dépassé mais n’ose le dire ; il est déjà accroupi, lui tenant toujours la main, l’attirant vers lui. Elle finit par s’asseoir. Il s’est allongé. Il lui semble que tant qu’elle ne pose pas la tête sur l’herbe, elle est maîtresse d’elle-même, aussi elle résiste encore. Il se redresse, passe son bras gauche autour de ses épaules, lui prend le menton de la main, l’obligeant à tourner le visage vers lui. Il est pas mal l’orchestre. C’est tout ce qu’elle dit. Les mots lui ont échappé, des mots inutiles, déplacés. Les larmes lui piquent les yeux. Il la pousse doucement vers le sol. Alors elle renonce et en ressent un soulagement. Quand il l’embrasse, elle doit surmonter le dégoût et la surprise à le sentir lui lécher avec insistance les lèvres. Il a passé la main sous son chemisier ; elle en suit la progression, guettant l’éveil d’un émoi. Jusqu’où la laisser s’aventurer ? Que font les autres filles quand elles s’éclipsent avec leur copain, que ressentent-elles ? Quand il dégrafe son soutien-gorge, elle ne proteste pas. Ses mains, pour l’instant, restent posées, inertes, sur le dos de l’homme. Il lui semble qu’elle doit faire un geste, participer en quelque sorte. Alors elle lui caresse les cheveux. Derrière l’ombre de son visage au-dessus d’elle, le ciel sans lune scintille. Elle a soudain une nostalgie aiguë du talus sous la maison quand, à écarquiller les yeux pour surprendre les étoiles filantes, à suivre le chemin de la Voie Lactée, à se laisser dériver dans les nuits d’été, un vertige violent l’emportait…
Quand ils reviennent vers les lumières, les musiciens ont rangé leurs instruments. Ils fument une cigarette, un verre de bière à la main. Derrière l’estrade, la chanteuse, le buste penché, brosse ses cheveux pour en faire tomber les confettis. C’est alors qu’il lui lâche la main, détourne ses pas, s’éloigne. Elle se contraint à sourire, ne veut pas sentir le vide à ses côtés, n’ose pas le suivre. Le cœur branlant, elle s’interroge, essaye de retrouver son aplomb. Comment marchait-elle ? D’une large poignée de main qui lui paraît excessivement cordiale, elle le voit saluer trois hommes qu’il a rejoints sur le perron de la mairie. Ils rient et sans qu’elle sache pourquoi, ce rire la blesse.
On te cherchait, on s’en va. Elle sursaute, nous dévisage. Sans doute pense-t-elle que dorénavant il lui sera plus simple d’être avec nous, qu’elle n’aura rien à expliquer, qu’il suffit qu’elle soit partie et revenue avec lui à ses côtés pour que les regards ne soient plus des brûlures. Elle attend notre sourire complice, quelques mots qui lui feraient franchir cette frontière invisible qui la sépare des autres. Mais nous, nous ne voulons rien savoir de cette fille qui nous ennuie. Déjà nous quittons la place. De l’autre côté, près de la buvette, Alain trinque avec ses amis sans un regard vers elle.
Temps fugitif : les écailles rouges et jaunes des hêtres et des taillis luisent sur le vert sombre des pins et des yeuses. Le ciel lavé par les pluies de septembre, la lumière est à la fois plus aiguë et plus douce. Les brumes chaudes de l’été ont disparu. Le facteur a un regard circulaire vers les collines auxquelles s’accrochent des effilochures de brouillard.
La bise va dégager tout ça.
De sa main libre, Annie prend le journal ; elle tient, coincée contre sa hanche, une corbeille d’osier. Sur les fils, les draps gonflés par le vent se mettent à claquer, l’effleurant au passage ; elle frissonne à leur contact mouillé et froid. Les vendanges sont terminées. Depuis le matin, sa mère et elle se sont attelées à mettre de l’ordre dans la maison qui, les ouvriers repartis, paraît plus vaste, plus froide aussi. Le silence est revenu, l’ennui des gestes répétitifs et nécessaires, la langueur des jours étales. Parfois devant le miroir de sa chambre, Annie s’observe, passant les mains sur ses hanches, effleurant son ventre. Les saignements ont repris sans qu’elle en soit ni soulagée ni déçue. Rien n’a changé. Le lendemain déjà, après le bal, face au miroir, elle avait cherché dans ses yeux, sur sa bouche, les signes, les traces d’une modification, les désirant et les redoutant tout à la fois, essayant de savoir ce qui pourrait se deviner. Elle s’était observée un moment puis avait passé avec soin un gant froid sur son visage pour le laver des dernières moiteurs de la nuit. Elle entendait sa mère s’activer en bas dans la cuisine. Inutilement, dans l’escalier raide et obscur, elle s’était composé un maintien ordinaire, consciente d’échouer dans la mesure même où elle le tentait : sa mère, occupée à écosser des haricots n’avait pas levé la tête.
À demain. Elle attend que la 2 CV du facteur disparaisse au tournant du chemin de terre. Sur les lignes électriques, les hirondelles s’affairent dans un raffut de trissements, préparant leur migration. Au matin, comme chaque jeudi, elle est descendue sur la place du village attendre le boulanger dès qu’il s’est annoncé de trois longs coups de klaxon à l’approche du pont de Colombe. Trois femmes bavardaient, assises sur la pierre lisse du lavoir. Elle les a embrassées.
Quand même, ces jeunes de S. avec leurs voitures et leurs mobylettes, ils cherchent les bêtises alors forcément un jour… Des voyous… gaspillent leur temps… traîner au café… Et puis toujours à faire hurler ou à trafiquer le moteur de leurs engins…
Elle s’est éloignée pour ne pas entendre les radotages. Les jeunes de S., elle ne voulait pas y penser, ne pas laisser revenir sa honte. Elle l’avait attendu au petit bal du lundi soir ; pas d’orchestre, des haut-parleurs accrochés au fronton de la mairie crachaient des danses vieillottes, tangos, marches et paso doble. Assise sur un banc de pierres, à l’écart, le dos appuyé contre une maison encore tiède, elle était restée à écouter la musique, les rires, les clameurs. Elle savait qu’il ne viendrait pas. Il avait dit, j’embauche à six heures. Malgré cela, elle l’avait guetté, humiliée d’être là.
Les femmes se sont tues puis l’une a ajouté à voix basse… C’est malheureux tout de même… et comme à regret… Trois morts… Ils rentraient de l’usine…
Enfermée dans la buanderie où flotte l’odeur douceâtre et tiède de la lessive, Annie ouvre le journal, l’étale sur la machine à laver, cherche. Là, sur la troisième page, un cliché trop sombre, quelques lignes :
Trois jeunes gens se tuent à la sortie de S. Leur voiture a percuté un platane dans la ligne droite. Le conducteur et ses passagers ont été tués sur le coup.
Elle lit, relit, scrute l’image. Il n’y a pas de noms. Relevant la tête, elle devine l’ombre de son visage dans le vieux miroir scellé au mur. Du bout des doigts, elle dessine dans la buée le contour de ses paupières ; une larme glisse, trace une ligne noire, hésite, s’arrête au bord de la vitre. À voix haute, elle dit… Alain.
Le soir venu, elle reste un long moment, assise en tailleur sur son lit. Les ciseaux à la main elle hésite, les yeux rivés sur la photo et les caractères noirs du titre, vide. La journée s’est étirée. Plier les draps, les nappes, les torchons. Laver les seaux et les paniers. Peler les coings et les pommes pour les pâtes de fruits. Tandis que côte à côte, sa mère et elle s’affairaient, l’envie de parler la tenaillait. Tu as vu cet accident à S. Sa voix était si basse que sa mère n’a pas relevé ; elle n’a pas osé répéter. Elle aurait voulu quelques mots anodins qui ne la trahissent pas, un bavardage, quelques banalités, celles qu’on échange sur le malheur des autres, qu’on ressasse avec une légère compassion, au bout du compte soulagé. Elle aurait pu dire j’en connais un, je crois. Elle aurait prononcé son nom encore une fois. Elle découpe soigneusement l’article, le plie, le glisse dans le tiroir de sa table de chevet.
Au petit jour, un volet claque et la réveille. Elle rêvait qu’elle dansait. Dans son dos, sa jupe se relevait et ondoyait en corolle, offrant ses jambes aux regards. Nulle gêne. Ses pieds glissaient, effleurant le parquet, s’emboîtant légèrement aux pas de son cavalier. Le bras autour de sa taille voulait l’empêcher de virevolter. Un instant, à la lisière de l’inconscience, il lui semble qu’elle vole encore. Elle ramène le drap sur sa poitrine, répète comme une invocation les derniers mots du rêve il ne pèse presque plus, tente de capturer les images, d’en retenir le fil. À voix haute elle dit son nom à lui puis son nom à elle. Elle en est comme intimidée, alors elle répète le premier -plus fort- une sommation, en attend un ébranlement qui ne vient pas. Elle repousse le drap, passe la main sous sa chemise de nuit. Allongée, son ventre paraît plus plat, paroi inquiétante et molle qu’elle effleure du bout des doigts, suivant sous la peau le lacis de ruptures sournoises qui l’ont abîmé. La chambre est froide et humide. L’image de Mado en robe noire, un mouchoir serré dans la main, flotte devant ses yeux. La pluie a repris, martelant les volets de bois. Il lui semble qu’il pleut sans discontinuer depuis des mois. Le vent tourbillonne, joue une sarabande autour de la maison. Les rafales dans le tilleul sous la fenêtre, le crépitement mouillé sur le gravier du chemin, le grondement des eaux de la Colombe qui roulent les pierres arrachées aux combes de marne, l’enveloppent, voix caressante et familière. Alors elle pleure. Elle n’a pas vu Mado depuis le début des vendanges. Tout à l’heure, elle lui portera des muscats de Hambourg.
De tout l’été, Mado n’a guère quitté la maison du Serre. L’agitation des vendanges la sort de son inactivité. Les ouvriers saisonniers viennent d’Espagne. Ils ne savent rien de son histoire, ne s’étonnent guère de ses vêtements sombres. Elle installe pour eux les couverts sur la longue table de la cuisine, prépare les paniers de victuailles. Les journées ne se traînent plus dans le silence. Les rires, les cris, parfois les prises de bec raniment la maison. Les parents et les frères, accaparés par les travaux, soucieux de la météo pluvieuse, allègent leur sollicitude. Sans qu’elle y prenne garde, Mado retrouve les gestes familiers, le plaisir de pétrir une pâte, d’arranger les grains de raisin ou les tranches de pommes, de voir dorer le sucre sur les tartes. Elle boite encore, alors elle ne va pas dans les vignes mais reste à la chaleur de la cuisine et, quand tous reviennent, boueux et détrempés, elle les aide à se débarrasser de leurs vêtements mouillés qu’elle s’occupe à faire sécher. Guapa chica ! dit Pablo, un vieil ouvrier édenté. Mado sourit. Quand la douleur revient parfois, comme une vague, elle s’affaire à préparer les repas, recoud un bouton à la chemise de l’un ou de l’autre, ravaude la manche d’un pull abîmée par un sarment.
Un après-midi, Annie vient la voir. Elle lui apporte des muscats de Hambourg. Chez elle, les vendanges sont terminées. Elle s’assied près de la fenêtre, dans le fauteuil d’osier, dit des banalités sans suite, dit qu’il y a eu un accident à S. puis se tait et laisse filer le temps dans un silence morne. Mado feuillette un journal de tricot, lui montre une veste chinée, les torsades doubles, les manches raglan.
Comment tu la trouves ? Je pourrais utiliser la laine de mon pull noir en y ajoutant une laine blanche.
Annie ne répond pas. Mado s’ennuie. Les ouvriers ne vont pas tarder. Elle se lève pour préparer le café et la collation. Annie s’en va.
Plusieurs jours de suite, elle revient sous un prétexte ou un autre, une recette à préciser, une pâte de fruits à partager. Mado a détricoté son pull noir, enroulant la laine autour du dossier d’une chaise pour en faire des écheveaux qu’elle a lavés et séchés. Annie l’aide à les remettre en pelotes et la regarde tricoter un échantillon puis monter les mailles du dos. Les mains, les doigts, les gestes qui s’enchaînent ; la boucle autour du pouce gauche, le fil souple sur l’index droit, que le mouvement régulier de l’auriculaire tend et relâche. Elle le sait, la chaîne de montage sera de la tension voulue, ni trop lâche ni trop serrée. C’est ainsi ; déjà à l’école, Mado était la plus habile, de l’abécédaire en point de croix au rucher du béguin, du point de riz au jour à l’anglaise. La vieille Madame Armand la couvait du regard. « C’est bien ma petite Mado, tu feras une bonne maîtresse de maison ! »
Annie cessa ses visites. De quel prétexte elle usa un jour pour contraindre Mado à emprunter le chemin abrupt qui grimpait dans les genêts et les prunelliers vers la grande maison des Marnières, je ne m’en souviens plus. Nous n’allions pas volontiers chez elle ; une maison sombre, trop vaste, trop silencieuse sur laquelle planait l’ombre écrasante de la grand-mère. Ce jour-là, Mado fut accueillie par la mère d’Annie qui la retint un long moment, l’interrogeant de sa voix presque chuchotée, avec sa curieuse façon, lente et doucereuse d’enchaîner les phrases sans marquer de pause. Trop curieuse à son goût, mais Mado ne savait comment l’interrompre. Annie est dans sa chambre, finit-elle par dire, la libérant.
Elle attendait dans la pénombre, le pied posé sur un pliant en toile, les volets mi-clos. À cause d’une migraine, s’excusa-t-elle. Sa cheville était bandée. Un accident, dit-elle sans plus d’explication. D’un mouchoir qu’elle gardait serré dans la main, elle se tamponnait les yeux. Sur sa table de chevet, la photo de l’été précédent prise à la fête de B. et une coupure de journal qu’elle ne lui montra pas ce jour-là. Sa mère apporta une chaise de cuisine inconfortable et proposa du thé. Prends quelques rochers aux noix ! Elle déposa sur le lit une boîte métallique bleue à la peinture écaillée, s’attarda, remercia Mado d’être venue. Tu sais ce que c’est, tu as vécu ça toi ! La conversation languissait, Mado ne comprenait pas, se sentait mal à l’aise. Une fois encore, Annie porta le mouchoir à ses yeux. Elle tourna la photo vers elle, la regarda longuement. Je n’ai pas pu l’enlever. Soudain elle se leva comme pour donner congé ; alors seulement Mado vit qu’elle s’était vêtue de noir, une jupe à godets et un pull. Annie montra sa cheville.
Je te raccompagne pas. Reviens demain.
Nous avions entre quinze et dix-huit ans, nous la trouvions laide et cela nous justifiait. Elle dressa pour moi l’inventaire du temps écoulé, usante litanie de naissances et de morts, de mariages et de séparations. Je m’éloignai, désireuse de reprendre ma promenade solitaire. Elle me suivit quelques mètres.
Viens prendre le thé un après-midi, répéta-t-elle.
Je bredouillai une vague promesse, agacée par son insistance et la laissai près d’une tombe, un arrosoir et un sécateur dans la main. Savait-elle que je n’irai pas ?