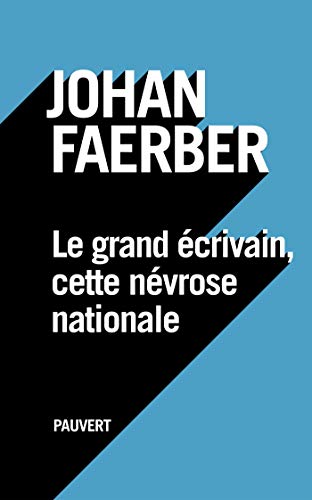L' Idée de littérature
Pendant que le confinement faisait fleurir les journaux d’écrivaines, certains critiques en profitaient pour muscler leurs essais. Ainsi de Le Grand Écrivain, cette névrose nationale, et de L’Idée de littérature, respectivement de Johan Faerber, co-rédacteur en chef du très dynamique site Diacritik et d’Alexandre Gefen, chercheur au CNRS. Tandis que le premier déplore « le désert politique dans lequel gît la critique aujourd’hui » et tente de secouer celle-ci avec force propositions, le second, en sous-titrant son livre « De l’art pour l’art aux écritures d’intervention », constate la démultiplication actuelle des formes littéraires et en appelle à une redéfinition de la « littérature » telle qu’on l’entend depuis la fin du XVIIIe siècle au profit d’une littérature « extensive et inclusive », en un mot, « démocratique ». Les deux critiques partent d’une scène publique pour s’interroger sur le devenir de la littérature (essentiellement narrative) contemporaine. Gefen s’empare ainsi du débat sur la nomination de Bob Dylan au prix Nobel de littérature pour réfléchir à ses implications théoriques et esthétiques, notamment en remettant en question l’autonomie de l’art pour montrer son implication grandissante dans la « cité ». Faerber, lui, commente le geste de Macron lors des funérailles de Jean d’Ormesson, à savoir déposer un crayon de papier sur son cercueil, pour sonder la persistance du mythe du grand écrivain, son impensé politique et son inanité littéraire. Il s’agit alors autant de révéler le caractère réactionnaire de ce fantasme de « grand homme » que de rabattre les prétentions de nombreux plumitifs. Le geste critique accompli par Gefen et Faerber est donc celui d’une délimitation du champ. Mais dans un cas cette délimitation prend l’apparence d’une synthèse historique et actuelle brillante et vaste, libérale, tandis que dans l’autre, la délimitation signifie non moins brillamment mais plus martialement, radicalement, à la fois l’élimination et l’élection.
Ainsi, dans L’Idée de littérature – qui aurait gagné à s’accorder au pluriel –, le champ envisagé est large, et s’étend à la fois du côté des best-sellers et du côté des formes numériques, telles les fanfictions. Au meilleur de ses passages, l’essai ouvre la perspective de chantiers collectifs nourris de différents courants critiques venus d’outre-Atlantique, et permet de s’interroger sur les mutations de l’objet littéraire dans la recherche. Mais parfois cela provoque des effets-listes déstabilisants, qui font par exemple cohabiter Houellebecq et Vuillard. De plus, malgré l’apparent œcuménisme de l’ouvrage, les marques de valeur ne manquent pas (comme middlebrow) et seraient à questionner davantage.
Nombre des textes cités par Gefen appartiennent à la littérature « sociable » que fustige Faerber. Tels les critiques de feue la rédaction des Cahiers du cinéma, celui-ci se rêve en tonton flingueur de certains récits à succès. Ses cibles sont les « romans à thèse ou autres romans à message qui confondent la littérature avec le bureau des postes », en particulier les romans représentant la société comme au bon vieux XIXe siècle, les « récits cataplasmes » et leurs larmes de crocodiles, prétendant consoler quand ils ne font que conforter le monde, et enfin l’autofiction, foyer de notre narcissisme franco-français. Les grands clients photogéniques y passent : Tesson « l’ermite le plus médiatique de France », Carrère, « petit Christ », Houellebecq « l’opinioniste absolu », Despentes « griot d’extrême-gauche ». L’art de la formule que déploie Faerber ferait passer les titreurs de Libé pour des amateurs.
La partie polémique de son livre est la plus réussie, la plus acérée et la plus drôle ; elle montre une grande acuité même si l’on ne partage pas toutes ses exécrations ni son adoration néo-barthésienne et inconditionnelle des figures de style. La partie laudative nous convainc moins. On découvre, comme dans un sketch des Inconnus, que s’il y a un mauvais grand écrivain, il y en a aussi un bon, sur lequel s’appuient sans le jalouser les bons contemporains. Et Faerber de verser à son tour (mais quel critique y échapperait ?) dans le mystique (le « monologue infranchissable » et la « nuit » de l’écriture), l’emphatique voire l’amphigourique (« forer l’hybris ») et le cocasse (quand « écriture rime avec taisure »). Il se contredirait même : si Vernon Subutex est néo-naturaliste, La Vie légale de Dominique Dupart qu’il encense n’est-elle pas également, avec toutes ses qualités, réaliste à l’ancienne ? Si Despentes s’adresse aux CSP+, à qui Dupart parle-t-elle ? Quant à la modestie salvatrice d’un Camille de Toledo ou d’un Pierre Michon, c’est à voir. A-t-on vraiment gagné à passer de l’écrivain « virilisé » dénoncé par Faerber à un « phallus caressant » (!) ? En tout cas, ces deux essais nous donnent matière à re-penser, non seulement les limites du champ littéraire, mais les gestes critiques qui le fondent.
Chloé Brendlé
Le Grand Écrivain, cette névrose nationale
Johan Faerber
Pauvert, 302 pages, 20 €
L’Idée de la littérature
Alexandre Gefen
Corti, 384 pages, 26 €