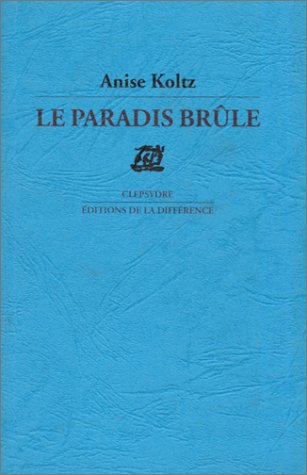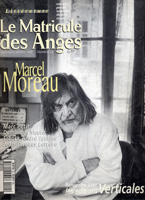Les poèmes d’Anise Koltz, publiés d’abord par les éditions Phi, sont plus volumineux qu’ils ne paraissent. S’ils ne rassemblent chacun qu’une petite poignée de vers, quelques mots perdus dans la blancheur d’une page, ils touchent tous aux questionnements essentiels de l’existence. Poèmes nucléaires en cela qu’il leur suffit de trouver le regard d’un lecteur pour se développer sans fin, pour créer des réactions en chaîne qui font appels aussi bien aux sens qu’à la pensée. La mort, le langage, les géniteurs, l’amour, la religion : on pourrait ainsi donner des titres aux différentes parties qui composent un recueil grave et violent. L’amour est au cœur de l’écrin bleu de cette collection, Clepsydre, que lancent les éditions de La Différence. Au seuil de cette partie, le premier poème est dédié (in memoriam) à René Koltz : « Je me penche/ sur le bord du monde// tu n’est nulle part ». L’amour serait donc le deuil de l’amour, le deuil de l’être aimé et disparu. Mais les poèmes qui suivent contredisent cela : « Mon corps est chaud/ comme le seuil d’une église// Quand tu entres en moi/ la bible divague ». Célébration de la fête charnelle, sensualité, désir, le poème est le lieu du présent éternel, de l’amour renouvelé. Avec une grande économie de moyens, Anise Koltz abouche l’homme et la femme dans un enlacement qui traverse corps et vies, et auquel elle donne la dimension d’un acte cosmogonique.
Les autres parties du recueil possèdent la gravité sereine de qui regarde sa propre mort. Pas d’exaltation ni de soupirs. La poétesse affronte le monde et, du haut de ses 70 ans, elle trouve les mots pour y désigner sa place : « La mer s’est retirée de nous/ les lignes de nos mains/ sont ses dernières empreintes ». Les images sont plus que justes, elles ouvrent à une connaissance métaphysique de l’existence, elles libèrent de l’angoisse sans se payer de mots. Et si la cruauté n’est pas exempte de ces pages (« Un squelette/ nage sous ma peau/ et se cogne/ à mes extrémités »), elle ne fait que définir un réel que la force du poème va transcender : « Ma porte d’entrée/ fournira le bois/ de mon cercueil // Que la possibilité/ de l’ouvert demeure ».
L’étonnement vient alors de ce que, malgré cette foi apparente dans le poème, Anise Koltz mine ce sur quoi il repose : le langage qui « sent la contrebande ». L’exercice est vain, inutile. Le poème est une sonde envoyée vers l’infini de notre condition qui jamais ne vient rapporter ce qu’il a trouvé. Icare, il se brûle au Paradis dont il s’est trop près approché : « Chaque poème s’écrit/ pour revenir au silence// Il est ultime// S’aventurant trop près de la mort/ il perd son chemin de retour ». Pour autant il est comme cette mer retirée de nous : les empreintes qu’il laisse sur la page permettent à chaque lecteur de reconstruire géologiquement son parcours. Il est comme un fossile, retrouvé sur un rivage et qui porte en lui notre histoire. Anise Koltz prévient ainsi son lecteur : « Je t’offre un poème/ comme un verre d’eau// Il ne désaltère pas/ Il te présente un lac/ où tu couleras à pic ». Et c’est en fin de recueil que le risque de noyade est le plus grand. L’auteur fouille les relations d’amour et de haine qui la relient à ses parents, à la mère surtout, fantôme de la culpabilité : « Chaque jour je mange/ mon père et ma mère/ avec du pain chaud/ crachant les touffes de leurs cheveux ». On aperçoit alors les victimes d’un holocauste après lequel l’écriture devient muette.
Le Paradis brûle
Anise Koltz
La Différence
151 pages, 89 FF
Poésie La parole fossilisée
septembre 1998 | Le Matricule des Anges n°24
| par
Thierry Guichard
A 70 ans, la Luxembourgeoise Anise Koltz nous donne à lire un recueil empreint d’une grande lucidité. De courts poèmes pour un long chemin.
Un livre
La parole fossilisée
Par
Thierry Guichard
Le Matricule des Anges n°24
, septembre 1998.