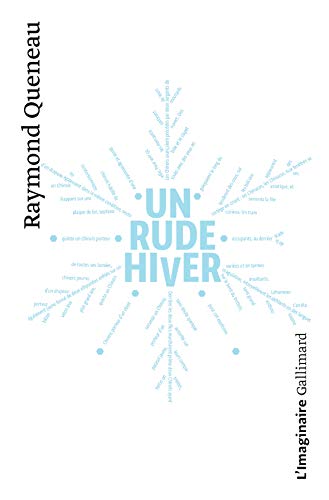Voici un roman (publié en 1939, soit vingt ans avant l’incontournable Zazie dans le métro) terriblement embarrassant. Principalement pour la critique. Que diable peut-on en dire, qui ne soit ni seule paraphrase ni simple énumération des faits et gestes de son héros (lequel n’en est pas un) ? Comment parvenir à montrer qu’il est riche tout en n’étant fait de rien (ou l’inverse), et qu’il offre au lecteur un vrai bonheur de lecture ?
Côté intrigue, il y a peu à dire. Quatorze chapitres, qui ressemblent à ce que sont les scènes pour un dramaturge (à chaque chapitre, un personnage fait son apparition, cependant qu’un autre disparaît provisoirement), et qui sont autant de moments dans ce rude hiver que traverse le protagoniste. Bernard Lehameau (tel est son nom, avec lequel on n’entre jamais totalement en familiarité) baragouine quelques mots d’anglais, bien qu’il soit interprète, mais sa singularité est ailleurs : un grand vide tout noir s’est creusé en lui (autrement dit : il ne va pas très bien ; d’ailleurs il est veuf). Un vide qu’il s’efforce de combler comme il peut (ses tentatives sont la seule matière du roman), par exemple en invitant des enfants au cinéma, ce qui n’est pas sans risque, puisque la fillette s’amourache de lui, ou en déjeunant chez son frère, qui lui reproche son pessimisme, ou en se promenant au bord de la mer avec miss Weeds, alias Helena (et c’est encore ce qu’il a de mieux à faire), auprès de laquelle il se découvre subitement malade de désir (c’est que le bonhomme a derrière lui 13 années de continence). Quand il en pince vraiment pour cette Anglaise qui dissimule ses formes derrière l’uniforme militaire, on en est déjà à la moitié du roman et, à force de sous-entendus, de situations douteuses laissées en suspens, peut-être aussi à cause de la guerre qui rend tout trouble, ou simplement parce que le lecteur n’a pas la pensée accaparée par l’intrigue, on a l’impression que tout le monde s’espionne et que Raymond Queneau (1903-1976) prépare un coup de théâtre délirant (il n’en est rien). Vers la fin du roman, alors que miss Weeds a été renvoyée outre-Manche pour défaut de conduite, on découvre chez le protagoniste de drôles d’idées, à commencer par celle-ci, dont il est fier, et qu’il s’empresse de révéler à qui veut l’entendre : il est persuadé que la France a besoin d’un protectorat allemand. Il faut dire à sa décharge qu’il vient de coucher avec Helena, et que ces retrouvailles avec le corps féminin l’ont quelque peu bouleversé : il ne hait plus ni les Allemands ni les Havrais c’est dire s’il est devenu sage.
Côté contexte, c’est la guerre, celle de 14-18, dont chacun s’empresse de prédire la fin, quelle qu’elle soit, pourvu qu’elle soit imminente seul Lehameau répète qu’elle durera. La guerre donc, mais vue du Havre, où Raymond Queneau vit le jour « un vingt et un février/ en mil neuf cent et trois », comme l’affirment les premiers vers de Chêne et chien (roman en vers publié en 1952), et où vivent de nombreux Havrais, au grand dam d’une libraire, la veuve Dutertre, qui tient ce citoyen pour « une buse, un obtus, un grossier avec une comprenoire d’une très faible ouverture de compas » (à ses yeux mais elle a la vue basse, Le Havre est une « ville de barbares »). En outre, c’est l’hiver, ce que confirment çà et là quelques informations météorologiques : « Il pleuvait bien doucement, mais méthodiquement, industriellement ». Et comme pour faire plus vrai, voici qu’à quatre pages de la fin il se met à neiger : « Un temps d’hiver, dit Lehameau gaiement. Un temps de février. S’il ne tombe pas de la neige en hiver, quand donc en tombera-t-il ? » De la neige en hiver, c’est la moindre des choses.
Autant le dire, cet hiver-là est rude, et pourtant on s’y sent bien. Mieux encore : on s’y amuse. On y retrouve tout ce qui fait la saveur du Queneau romancier. Sa fantaisie, qui lui fait abandonner un détail plaisant là où personne ne l’attend. Ses acrobaties syntaxiques (« De sa chair, il ne pressait entre ses mains que celle de ses, qu’elle avait maigres et osseuses comme un garçon »), ses déformations lexicales et orthographiques, notamment avec l’anglais (« Aïe laïe-ke zatt »). Ses personnages, toujours issus des classes populaires, et sur lesquels il porte un regard plein d’indulgence. Ses situations enfin, qui ont toujours quelque chose d’extravagant le ton est d’ailleurs donné d’emblée, dans ce premier chapitre qui parachute le lecteur au milieu d’un défilé d’Asiatiques, dans lequel se mêlent un chameau et plusieurs Chinois, dont un portant un parasol jaune. Queneau avait raison : « Y avait des rigolos sur la terre ».
On peut aussi se laisser à formuler des hypothèses de lecture, se demander si Un rude hiver n’est pas simplement une étude : qu’advient-il à un homme qui n’a pas embrassé de femme depuis treize ans ? On peut d’ailleurs se perdre en conjectures, se replonger dans le roman. Et sans doute qu’après maintes lectures le lecteur fera-t-il siens les propos de Georges Perec, pour qui ce roman s’acheminait « doucement vers l’inépuisable ».
Un rude hiver
Raymond Queneau
Gallimard,
« L’Imaginaire »
182 pages, 6,50 €
Intemporels Queneau story
juillet 2006 | Le Matricule des Anges n°75
| par
Didier Garcia
L’histoire émouvante et burlesque d’un veuf qui, en temps de guerre, occupe ses jours comme il peut pour revenir à la vie. Éblouissant.
Un auteur
Un livre
Queneau story
Par
Didier Garcia
Le Matricule des Anges n°75
, juillet 2006.