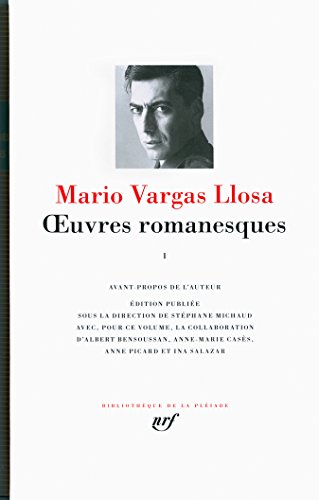Aujourd’hui la triste situation dans laquelle se trouvent, pour des raisons différentes, le Venezuela ou le Mexique semble mettre à mal les espoirs que faisait naître, hier encore, le socialisme neuf qui là-bas, en Amérique latine, s’inventait. Dans les années 70, dans le sillage de l’exemple cubain qui enchanta, quelque temps, aussi bien Sartre que Debray, beaucoup rêvaient d’y aller jouer au guérillero. Mais c’est la décennie précédente qui avait placé l’Amérique latine au premier plan en un autre domaine : on parlait alors du « boom latino-américain » pour saluer l’admirable et prodigue moisson des romanciers de Colombie, du Pérou, d’Argentine… Alors que Borges les avait déjà précédés dans la reconnaissance mondiale, les nouveaux venus, des aînés – Carpentier, Cortázar, Sabato – aux plus jeunes – García Márquez, Fuentes, Puig – offraient au roman des voix et des voies multiples. Mario Vargas Llosa n’était pas le moindre de ces explorateurs du territoire romanesque, de ces sortes de Christophe Colomb à l’envers qui prenaient ainsi une sorte de revanche : leur périphérie devenait le centre. Vargas Llosa se fit connaître en 1962 (il est né en 1936) avec La Ville et les Chiens, un roman qui s’inspirait de son adolescence péruvienne mais qu’il avait écrit en grande partie « dans une mansarde à Paris ». Ayant en lui depuis des années « la passion de la culture française et le rêve de pouvoir un jour vivre à Paris et devenir un véritable écrivain », il s’y installa, en effet, et y écrivit, de 1959 à 1966. Voir aujourd’hui ses romans réunis dans la Pléiade est donc pour lui une joie et un symbole : à chacun de ses anniversaires, rappelle-t-il dans son avant-propos, il s’achetait un volume de cette collection qui constitue « la bibliothèque idéale, éternellement jeune et éternellement renouvelée ».
Sans doute le choix des responsables de cette édition fut-il difficile : comme le titre l’indique, la décision a été prise de s’en tenir aux œuvres romanesques, et parmi celles-ci, seuls huit romans furent retenus – sur la vingtaine que Vargas Llosa a écrite à ce jour. Nous ne trouverons donc pas ici ses essais – nous pouvons conseiller les volumes passionnants que sont L’Orgie perpétuelle à propos de Flaubert, La Tentation de l’impossible sur Hugo et Les Misérables, et le recueil d’articles intitulé La Vérité par le mensonge – ni ses pièces de théâtre. N’y figure pas non plus son autobiographie – Le Poisson dans l’eau – entreprise à la suite de sa malheureuse candidature à l’élection présidentielle de 1990 remportée par son concurrent Fujimori, qui allait gouverner le Pérou de manière quasi dictatoriale. Ces huit romans, cependant, couvrent la presque totalité de la création de Vargas Llosa, du premier – La Ville et les Chiens donc – à un de ses derniers – Tours et détours de la vilaine fille, publié en 2006. Outre cette dimension chronologique, le choix correspond sans doute aussi à la volonté de rendre compte de la diversité thématique et, en même temps, de certaines constantes, de certains leitmotivs. Nous sont ici offerts aussi bien des romans de l’apprentissage sentimental et sensuel, politique et moral (La Ville et les Chiens, Tours et détours de la vilaine fille) que des évocations puissantes de la dictature, de ses excès et de ses ravages (Conversation à La Catedral, La Fête au Bouc), des épopées pleines de bruit et de fureur, au cœur de l’Amazonie ou du sertao brésilien (La Maison verte, La Guerre de la fin du monde), que des peintures de la vocation qui s’empare de certains, qu’il s’agisse du feuilletoniste génial et ridicule à la fois de La Tante Julia et le Scribouillard ou des deux destins, évoqués en diptyque révélateur, de Flora Tristan, parcourant la France de 1844, et de son petit-fils Gauguin, s’exilant à Tahiti puis aux Marquises, tous deux recherchant Le Paradis – un peu plus loin, l’une dans le socialisme, l’autre dans l’art.
« Le roman peut proposer une reconstruction aussi minutieuse et aussi vaste de la réalité qu’il semble rivaliser avec le Créateur, pulvérisant et refaisant – rectifié – ce qu’il a créé ».
Si chacun de ces romans constitue bien sûr une expérience de lecture particulière, ils ont tous en commun une même ambition et offrent ainsi le même plaisir au lecteur : celui d’être plongé, embarqué véritablement dans un monde qui veut faire concurrence, avec les armes de l’imagination et du récit, au monde réel. De belles formules de Vargas Llosa témoignent de ce qui pourrait sembler une hubris d’un autre temps (celui de Balzac, de Flaubert ou de Hugo) – mais c’est précisément cette démesure que vint sans doute récompenser, en 2010, le prix Nobel. Pour Vargas Llosa, en effet, « le roman peut être un déicide, proposer une reconstruction aussi minutieuse et aussi vaste de la réalité qu’il semble rivaliser avec le Créateur, pulvérisant et refaisant - rectifié – ce qu’il a créé ». Le romancier ne doit pas hésiter à être « omnivore » et ne doit pas cesser de poser les questions les plus troublantes : « un roman n’a pas à fournir de réponse à ces questions ; s’il sait les susciter, comme émanation naturelle et inévitable d’une fantaisie qui nous maintient sous le charme durant sa lecture, puis persiste et s’enrichit dans le souvenir, il a amplement rempli sa mission ». Nul doute que le lecteur, après avoir vécu les six cents pages (en Plé-iade) de la Conversation à La Catedral ou de La Guerre de la fin du monde (les deux romans auxquels Vargas Llosa lui-même dit tenir le plus) aura été confronté à une telle multiplicité de personnages et de situations que ce voyage dans la fiction suscitera en lui, longtemps après encore, réminiscences et réflexions.
Si les modes de narration et la conception architecturale de chacun de ces romans sont tout aussi divers que leurs thèmes, on décèle cependant ici une certaine simplification (qui n’est pas appauvrissement). Les trois premiers romans, en effet, exigent du lecteur patience et sagacité afin de suivre les méandres et ruptures d’une narration à la Faulkner – ce que Vargas Llosa revendique. Qu’il s’agisse de dépeindre les tourments du jeune Alberto confronté à la violence du lycée militaire où l’a envoyé un père abusif (La Ville et les Chiens), ou le spleen de Santiago, nouveau Frédéric Moreau, médiocre journaliste sous la dictature humiliante du général Odria (Conversation à La Catedral), la multiplicité des narrateurs et les bouleversements chronologiques confèrent au roman sa richesse mais aussi sa complexité. Était-ce dû au contexte (entre le Nouveau Roman et les dérives textualistes et telquelistes qui suivront) ou à l’ambition d’un jeune romancier débordant d’énergie ? Les romans suivants, même s’ils jouent toujours avec la temporalité et mettent toujours au premier plan les dialogues (le travail sur l’oralité comme sur les voix propres à chaque personnage a sans doute exigé la plus grande précision des traducteurs), proposent au lecteur des narrations tout de même plus linéaires, à la construction plus mesurée : La Tante Julia et le Scribouillard, par exemple, alterne les chapitres consacrés aux amours de l’apprenti-écrivain (le « scribouillard ») et les textes échevelés du radio-feuilletonniste Pedro Camacho.
Quelle que soit, donc, la forme choisie, le lecteur se trouve projeté comme au cœur d’un de ces panoramas qu’inventa le XIXe siècle : au milieu des personnages multiples mais aussi du décor urbain ou du paysage qui les entoure et les influence, qu’il s’agisse de Lima, la ville natale de l’auteur, de l’angoissante Saint-Domingue du dernier jour du dictateur Trujillo (La Fête au Bouc) ou, dans Les Tours et détours de la vilaine fille, du Paris de la jeunesse de Vargas Llosa, ressuscité avec d’autres villes où ne cesse de fuir et se réincarner la « vilaine fille ». Là se débattent des antihéros confrontés au ratage de leur vie, des révolutionnaires idéalistes qu’attend une mort inutile, des dictateurs effrayants et pathétiques à la fois, et des femmes désirables. Voici un festin de fictions pour les temps de crise que nous traversons – puisque, comme l’écrivait Flaubert : « Le seul moyen de supporter l’existence, c’est de s’étourdir dans la littérature comme dans une orgie perpétuelle ».
Thierry Cecille
Œuvres romanesques I et II
de Mario Vargas Llosa
Édition publiée sous la direction de Stéphane Michaud, Gallimard – La Pléiade, tome I 1952 p., 65 e ; tome II 1868 p., 65 €
Domaine étranger Une somptueuse abondance
juin 2016 | Le Matricule des Anges n°174
| par
Thierry Cecille
C’est à la découverte d’une œuvre-monde que nous convient les deux volumes que la Pléiade consacre à Mario Vargas Llosa, à un festin romanesque pantagruélique.
Un livre
Une somptueuse abondance
Par
Thierry Cecille
Le Matricule des Anges n°174
, juin 2016.