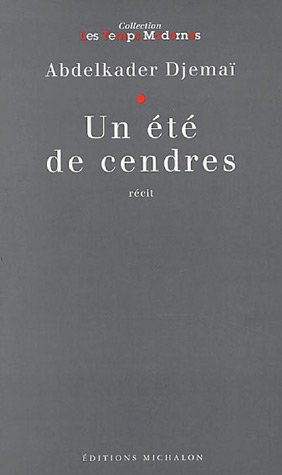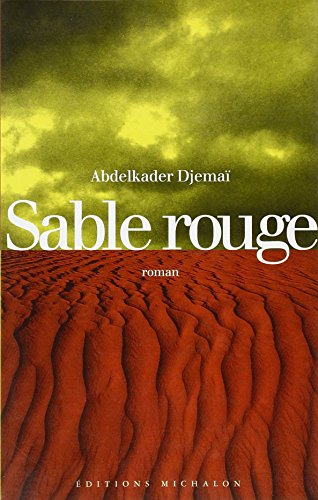Ma tête est semblable à ces outres où les Indiens transportent, au gré de leurs migrations, les os de leurs ancêtres » écrivait le romancier et poète Tahar Djaout. Ces lignes, extraites de L’Invention du désert, pourraient servir d’exergue aux deux romans qu’Abdelkader Djemaï a publiés en France, où il s’est installé en 1993. Dans l’œuvre de ce journaliste né à Oran en 1948 et venu assez tard à l’écriture romanesque1, Un Été de cendres (1995) et Sable rouge constituent un ensemble : ensemble défini par une écriture poursuivie et en partie reprise, réappropriée dans l’exil (« Écrire dans les villes froides », selon les mots de Tahar Djaout), ensemble défini par une écriture conçue comme une réponse à la guerre algérienne, mais qui ne se laisse pas réduire à un discours didactique, politique au sens professionnel du terme ; ensemble défini, en outre, par une écriture en quête d’une parole enfouie, d’une « langue des morts », pour reprendre l’expression d’Assia Djebar. « On écrit avec les morts et pour les morts, pour faire place aux disparus » note Abdelkader Djemaï. Un Été de cendres et Sable rouge, dernier livre paru, sont deux œuvres jumelles ; elles mettent toutes deux en scène l’existence quotidienne d’un homme réfugié au cœur d’une ville méditerranéenne et sur lequel pèse une « menace ». « Les lettres (…) adressées aux futures victimes contenaient parfois un cercueil de la taille d’une boîte d’allumettes, un morceau de drap blanc en guise de linceul… » La terreur abolit la frontière séparant le dedans du dehors, la possibilité d’une trêve : « Ici, dans l’appartement, entre deux meubles et une table basse, dans cette chambre, (…) la fenêtre lui paraissait parfois fausse, sans échappée (…). Plaquée sur une surface plate et aveugle, elle n’offrait plus le jeu subtil et ambigu de l’ombre et de la lumière. » Les paroles de Sid Ahmed Benbrik, le narrateur d’Un Été de cendres, s’impriment à même l’air blanc de la ville, comme une succession de traces ténues et concentrées, blocs de mots d’où l’émotion semble sourdre. « Ce récit, remarque Abdelkader Djemaï, est peut-être fait pour être lu à haute voix. Il y a toujours une écoute de la langue, une langue parlée, articulée, au moment où j’écris. » L’Algérie n’est jamais nommée dans ces textes, mais cette omission trouve sa source en amont, dans le style rigoureux, entier de l’auteur, dans son adéquation, sa fidélité presque aveugle à la situation de vie décrite, beaucoup plus que dans un projet préalable, finalement extérieur, au texte : Abdelkader Djemaï, c’est peut-être sa première qualité littéraire, parvient à écrire à partir de conflits, de situations, d’événements propres à l’Algérie contemporaine sans jamais s’installer dans le registre de l’allusion. « Je ne peux pas parler de l’exil des autres. Il s’agit pour moi d’un exil profitable dans la mesure où il m’a placé face à moi-même en tant que créateur. L’exil n’a pas fait de moi un martyr, il a fait de moi un être conscient. Sur le plan de l’écriture, cela m’a acculé. « Tu vas faire un livre. Attention. Il faudra en porter la responsabilité. » Il fallait être au plus près, des choses, des êtres, essayer de témoigner avec les mots de chaque jour, sans verser dans l’apitoiement. » N’intégrer au texte que ce qui relève de son mouvement propre, écrire à partir d’une sorte de point minimal de vie, d’une expérience presque pétrifiée (préparer le café, se retrancher dans sa chambre, surveiller les allées et venues de l’immeuble, aller à la fenêtre, allumer et éteindre la lumière, lire, fumer), dans le respect tendu d’une forme particulière d’immobilité et d’attente : telle est la voie que l’auteur semble s’être ménagé pour échapper aux écueils proches, pour répondre à l’urgence tout en ne cessant de lui disputer, pied à pied, l’espace de l’écriture. « À un moment je m’arrête, je ne veux pas en dire plus, remarque-t-il. Je veux que mon écriture fonctionne sur la rétention. Je crois que j’ai fait des livres libres. J’appartiens à une génération qui a beaucoup fonctionné sur la culpabilité et j’ai envie d’être libre par rapport à une… par rapport à ma culpabilité. » Un Été de cendres et Sable rouge sont deux œuvres jumelles, mais leur ressemblance dépasse le seul cadre de l’œuvre personnelle : l’air de famille, les traits communs sont peut-être aussi nombreux entre ces deux livres qu’avec le roman d’Amine Touati, Peurs et mensonges, publié dans la première livraison de la revue Algérie Littérature / Action, qu’avec le Journal de la douleur et de l’espérance algériennes du journaliste Mouloud Belabdi diffusé sur France-Culture en mars 1995, qu’avec L’Année des chiens, roman des lignes de fracture, des lignes de fuite, des discontinuités de l’Algérie contemporaine. Ces textes ont pour points communs d’être rédigés dans l’exil le moins confortable et dans une césure historique qui menace gravement la continuité, c’est-à-dire l’histoire même de la littérature algérienne : les circonstances de la mort de Tahar Djaout, assassiné par un jeune islamiste en 1993, pèsent sur Sable rouge à la façon d’un motif récurrent, obsessionnel, comme sur le travail d’éclaircissement, d’élucidation, de retour sur soi accompli par Assia Djebar dans son dernier livre (Le Blanc de l’Algérie, Albin Michel, 1995). « Le personnage du livre est seul, sans totem ni tribu, insiste Abdelkader Djemaï. Seul avec ses mots, avec l’image de son père. Je crois que la signification de Sable rouge, c’est aussi cela : l’individu devant une tragédie collective. On s’est toujours abrité derrière un « nous », derrière des lendemains qui chantaient. Ici, on a affaire à des individus, à leur propre vie privée, leurs propres qualités, leurs propres histoires, leurs propres angoisses. »
Ces textes ont encore en commun de remettre en cause la culture politique nationaliste dans laquelle l’état algérien a, depuis 1962, puisé par brassées héroïques et voraces sa légitimité. Les Chercheurs d’os Tahar Djaout (Seuil, 1984), qui relate la pérégrination pathétique de deux paysans en quête, au lendemain de la guerre d’indépendance, des ossements d’un jeune homme mort au combat, a peut-être inauguré cette remise en question, ce retour nécessaire à l’un des points de départ de l’histoire algérienne. Le chemin parcouru par Abdelkader Djemaï depuis Un Été de cendres -récit de l’affrontement, du face à face obtus, récit parfaitement linéaire, enfermé dans un présent coupé de tout passé et de tout avenir- jusqu’à Sable rouge, illustre cette exigence redoublée : relier la période contemporaine aux jours de la guerre de libération et aux premières années de l’indépendance, exhumer les racines du deuil.
« (…) je pose la question suivante : la colonisation a-t-elle vraiment mis en contact ? demandait Aimé Césaire en 1955 (Discours sur le colonialisme, Présence Africaine, 1995). Ou, si l’on préfère, de toutes les manières d’établir contact, était-elle la meilleure ? / Je réponds non. / Et je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie ; que, de toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles expédiées, on ne saurait réunir une seule valeur humaine » L’histoire d’un peuple colonisé est faite par ceux qui la défont, faite en même temps qu’elle est défaite ; les deux termes sont devenus exactement synonymes. Les écuyers tranchants qui ont « fait » en ce sens l’histoire de l’Algérie y ont introduit un principe de division qui a perduré, s’est ramifié après leur départ en générant des archaïsmes, des points de blocage, des violences sans liens apparents avec les violences antérieures. C’est ce principe de division que Sadek Aïssat s’est efforcé de transcrire en embrassant dans son premier roman, L’Année des chiens, le présent, le passé proche et le passé lointain de l’Algérie. Il n’est pas étonnant, dès lors, de retrouver dans l’histoire de ces deux frères dont la division revêt peu à peu une dimension mythique, un écho du Nedjma de Kateb Yacine. « Au départ, je ne voulais pas écrire pour les Français, mais pour mon peuple. Puis je me suis dit : « De toutes façons il faut écrire aussi pour les autres », et peut-être qu’il faut écrire pour les autres, précisément : écrire pour l’autre implique qu’on écrive pour dire des choses qu’il ne voit pas. C’est pour cette raison que j’ai eu cette… j’allais dire cette angoisse, oui, d’essayer d’écrire un livre réellement algérien. J’avais lu Nedjma, je l’ai relu quand je suis venu en France. C’est un livre que j’aime parce qu’il paraît écrit en arabe. »
« L’usage de la langue française en Algérie, remarque encore Sadek Aïssat, est le résultat d’un viol. L’enfant de ce viol est un enfant bâtard, et c’est cette bâtardise qu’il nous faut assumer, exactement de la même façon qu’on doit porter autant d’amour à un enfant bâtard qu’à un autre. » Les personnages de L’Année des chiens sont les jeunes des quartiers pauvres d’Alger - « âmes sèches », pour rappeler Aimé Césaire, prêtes à brûler « aux feux des premières révoltes » -, jeunes gens inactifs adossés aux murs de la ville et en lesquels Kateb Yacine, peu avant sa mort, reconnaissait le vrai visage de l’Algérie contemporaine. « Nous nous attardions auprès d’un vieil aveugle au visage de patriarche respectable. Le son de son violon, qui devait sa plainte grave et caustique aux cordes en crin de cheval de l’instrument, la voix pathétique et brisée du vieil homme nous saisissaient » : « c’est probablement là, à l’interférence des odeurs, des paroles et des sons plaintifs d’un violon, que le sanglot se noua dans nos gorges et y entama son œuvre corrosive, comme la scansion têtue de la récitation creusait nos poitrines à l’école coranique. » Un ancien communiste algérien, qui quitta le P.C.A. pour s’engager dans l’armée de libération nationale, mais que ses compagnons de maquis mutilèrent (« On aurait pu passer sous silence sa passion pour le tabac et son amour pour l’herbe, mais pas ses idées politiques. Pouvait-il deviner que les lendemains chantés n’étaient pas ceux qui se préparaient ? ») rejoint ces jeunes gens sans héritage. Ils habitent un désert, eux qui boivent du vin « dans des assemblées où les hommes se mêlent aux femmes » et le plus souvent seuls, entre amis, dans les chambres de l’un ou de l’autre. Ils engloutissent des monceaux de pain rassis et des olives mises à macérer dans des seaux en plastique, à la fin des nuits blanches passées à écouter le chanteur El Anka et les musiciens de châabi sur un petit magnétophone. Ils deviennent fous, portent une parole trop ample qu’ils ne parviendront pas à entendre jusqu’au bout, qui les terrasse. La répétition emporte l’âme, cette répétition qui, comme le souligne Sadek Aïssat, est le propre de la langue arabe. Les heures les plus riches, de communion, d’amitié, les heures où une autre vie semble possible forent aussi l’âme et le corps. L’illumination cèdera la place à une mauvaise fébrilité. L’espérance prépare des regards fendus. « À trente-cinq ans, (Omar) était saoul tous les soirs. Cela faisait déjà neuf ans qu’il attendait de pouvoir se procurer un logement. Il voyait sa fiancée de temps à autres et passait avec elle une après-midi dans un hôtel quelconque ; ils le pouvaient parce qu’ils avaient un livret de famille. En fin de journée, il la raccompagnait chez elle. Il avait eu le malheur d’être le plus jeune de sa famille. Dans la maison familiale, toutes les pièces étaient déjà occupées ; le dernier de ses frères à se marier avait transformé la salle de bains en chambre nuptiale. À quarante-deux ans, Omar ne supporta plus d’attendre. C’était un matin d’été et je fus l’un des premiers à le voir, alors que je sortais de chez moi. Il avait revêtu le costume acheté pour son mariage, seize ans plus tôt. J’aperçus d’abord ses jambes raidies, puis ses mains accrochées au parapet du balcon, les doigts comme des serres blanches, avant de voir la cravate à laquelle il était pendu. » Sadek Aïssat a traduit dans L’Année des chiens l’essence de sa nostalgie et un lien indéfectible, qui l’anime, entre l’espoir et le désespoir, une douceur et un regret terrible. « Par ses racines infiniment voilées, écrivait Abdelkebir Khatibi en 1978, la langue irrigue le deuil chanté du poète. »
« Cette quête de ce qui est humain, je crois que c’est ce qui va nous sauver, nous sortir de ces malheurs -on s’entretue parce qu’on est différent, on s’entretue parce qu’on est d’une tribu voisine…, conclut l’auteur de L’Année des chiens. Je ne crois plus tellement à la politique, j’en ai fait pendant dix-huit ans, en professionnel pratiquement puisque j’ai été durant près de quinze ans permanent du Parti Communiste Algérien. J’en ai arpenté un peu tous les sentiers. Je ne crois plus à la politique mais je crois à la culture ; si on peut faire quelque chose, rencontrer les gens, aller au-delà, au devant d’eux, c’est par la culture : cette différence est ce qu’on a de plus beau à offrir, ce qu’on a de plus beau à prendre des autres. »
Dimitris Alexakis
1 Abdelkader Djemaï a publié à Alger, aux éditions E.N.A.L., Saison de pierres (1986) et Mémoires de « nègre » (1991).
Sable rouge
Abdelkader Djemaï
Éditions Michalon
176 pages, 90 FF
L’Année des chiens
Sadek Aïssat
Éditions Anne Carrière
207 pages, 95 FF
Domaine français Algérie, racines du deuil
Abdelkader Djemaï et Sadek Aïssat transcrivent les divisions de l’Algérie contemporaine. Sur les traces de Kateb Yacine et de Tahar Djaout, et dans l’exil, partagé avec plusieurs autres écrivains algériens de langue française. Rencontres.