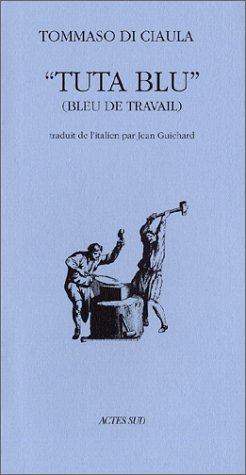Installons-nous pour un temps dans les Pouilles, cette région du sud italien. Plus exactement à Bari, d’où les ferries s’élancent vers l’Albanie ou Corfou, et où naguère l’on pouvait tranquillement pêcher la crevette (aujourd’hui, la côte adriatique n’est plus qu’une « porcherie »). Dans la périphérie de Bari, comme dans la périphérie de toute ville industrielle : des usines, et parmi elles l’usine Fiat, dans laquelle chaque jour des centaines d’individus abandonnent leur statut d’être humain pour celui d’ouvrier, afin de rejoindre les fourmis bleues déjà à pied d’œuvre dans l’immense fourmilière. Des fourmis bleues, ou bien « des singes, des robots, des automates ».
Dans cette usine, nous trouverons un ouvrier vraiment pas comme les autres. Il se nomme Tommaso Di Ciaula. Celui-ci délaisse la cantine le midi pour musarder dans la campagne, observer les bourgeons et les fleurs. Pire encore : il écrit. Et pourtant, lui qui fut recalé par trois fois à l’examen d’entrée au collège et qui dut fréquenter l’école professionnelle d’agriculture, rien ne le prédisposait à l’écriture (il nous dirait peut-être que rien ne le vouait non plus à devenir un ouvrier métallurgiste et à devoir s’affubler chaque jour d’un bleu de travail). Rien ne le destinait à être traduit en français, en allemand, en espagnol, et à figurer dans les anthologies de la littérature italienne contemporaine. Un destin singulier qu’il doit pour l’essentiel à « Tuta blu » (publié en 1978 en Italie, en 1982 en France, et à ce jour son seul livre publié en français), même si les lecteurs transalpins ont aussi pu se frotter à ses deux recueils de poèmes et son volume de souvenirs touchant à son enfance et à son adolescence.
D’après le propre aveu de Di Ciaula, ce livre souhaitait « donner la parole à des siècles de silence de la classe ouvrière », tout en n’étant « pas seulement une coupe de vie en usine » mais aussi « un livre qui parle de civilisation paysanne, de politique, de rêves ».
Évidemment, ce livre a d’abord valeur de témoignage, mais sans que l’ouvrier en profite pour trop longuement s’épancher. Il y évoque les usines du passé, avec leurs chiottes sans portes, les ateliers en tôle (« tu te grilles les couilles l’été (…) et tu te les gèles l’hiver »), le tour qu’il utilise huit heures durant, les accidents de travail, les séjours à l’infirmerie, et les conditions dans lesquelles chacun se trouve contraint de travailler. Avec, pour toute règle de conduite : le sacro-saint rendement. Et bien sûr, l’obligation de tenir : « Quand je pense que je dois faire des milliards de pièces pendant encore vingt-cinq ans, ça me donne envie de tout casser, de tout jeter en l’air comme font les fous ». Il y travaille d’ailleurs encore.
On s’en doute, la satire sociale n’est jamais bien loin. Sur son casier, ses collègues ont longtemps pu lire cette inscription : « Vive la révolution, nous devons changer la société, chasser les monstres, chasser les voleurs ». Quand le contremaître lui demande de s’expliquer sur ces mots, il répond que pour lui cette phrase c’est beaucoup : « elle me tient compagnie, elle me remonte, elle me donne une raison de vivre ». Sans défendre la moindre thèse, il s’en prend aux cadences infernales qu’on leur impose, déplore qu’on soit en train de leur confisquer leur mémoire, et défend bien sûr la cause ouvrière, c’est-à-dire celle de ceux « qui l’ont dans le cul du matin au soir ». Autant de récriminations qui le poussent à de fréquentes diatribes contre le capitalisme.
Et pourtant, la saveur de ce livre est ailleurs. Di Ciaula y procède par petits blocs de prose qui se suivent sans dépendre les uns des autres : sa pensée progresse par ricochets, pratiquant allégrement le coq-à-l’âne. Une manière qui surprend toujours le lecteur, lequel ne peut jamais savoir de quoi le paragraphe à venir sera fait. Sur une même page, l’auteur peut y évoquer son boulot, mais aussi une laitue (et l’art de l’assaisonner), ou un souvenir de son passé. Et les souvenirs y sont légion. Il n’y a d’ailleurs que le passé qui soit beau : tout y paraît magnifique, embelli par la perte, magnifié par le deuil. Le passé, pour Di Ciaula, c’est surtout la nature, cette campagne où il rêve de faire « un de ces sommes calmes et profonds d’autrefois dans le silence des champs », ces villages qui avaient encore leurs propres fêtes, et la mer, qui ressemblait à une vraie mer. Dans ces paragraphes, la poésie affleure presque à chaque phrase ce qui crée un surprenant contraste avec le franc-parler dont il use dès qu’il s’agit de l’usine.
La richesse de « ce récit » sans prétention tient dans la matière qu’il empoigne : on sent que tout est possible, et qu’une telle flânerie dans la vie de Di Ciaula pourrait durer cinq cents pages sans jamais lasser le lecteur. On en sort d’ailleurs métamorphosé, comme restitué au plaisir de la vue. C’est elle qui permet à l’ouvrier de tenir encore débout : sa seule liberté réside dans sa capacité à appréhender ce qui se trouve au-delà de l’atelier. À se tourner vers le réel, qui est pour lui le lieu du rêve. Et d’une vie toujours possible.
« Tuta blu »
(Bleu de travail)
Tommaso
Di Ciaula
Traduit de l’italien par Jean Guichard
Actes Sud
200 pages, 15 €
Intemporels Les fourmis bleues
avril 2005 | Le Matricule des Anges n°62
| par
Didier Garcia
Quelque part entre le journal et la note, entre le présent de l’usine et les beautés de l’enfance : Tomasso Di Ciaula, ouvrier prosateur.
Un auteur
Un livre
Les fourmis bleues
Par
Didier Garcia
Le Matricule des Anges n°62
, avril 2005.